Dans le documentaire L’Énigme Velázquez qui sort en salles, Stéphane Sorlat explore la complexité des œuvres du peintre des puissants et des petites gens.

Il existe des chronologies de l’art : baroque, classicisme, impressionnisme, post-impressionnisme… Les périodes se succèdent, parfois se chevauchent, les historiens classent, l’histoire avance. En réalité, les frontières temporelles s’avèrent plus floues que les entrées de dictionnaires. Rien de grand ne s’arrête vraiment. L’Énigme Velázquez part d’une idée qui déstabilise nos habitudes : et si l’ère baroque n’était pas vraiment achevée ? Et si Diego Velázquez, né le 6 juin 1599, n’était pas tout à fait mort le 6 août 1660 ? Le plan du film n’obéit pas à une structure classique de dissertation. Il s’ouvre par un extrait de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (qui cite lui-même Élie Faure !). Diego Velázquez reste, selon la célèbre formule d’Édouard Manet, « le peintre des peintres ». Aussi, son ombre plane, intacte, sur la création moderne, sur la peinture et la sculpture, le théâtre ou encore le cinéma. Le récit peut donc zigzaguer librement, de Francis Bacon à Julian Schnabel, au gré d’interviews d’historiens, de commissaires d’expositions, d’extraits d’opéras… Ce plan buissonnier peut déstabiliser les esprits les plus rigoureux, habitués aux échafaudages théoriques structurés. Dès son générique, aux mouvements identifiés par l’histoire de l’art, le film préfère ceux de l’eau, constants, ornés de reflets, secoués de remous indistincts. Ces images aquatiques accompagnent un ballet d’œuvres que l’on observe sur grand écran au plus près de la main du maître. Diego Velázquez, peintre des rois et des puissants, mais aussi des bouffons et des plus humbles : son humanisme éclate devant les rétines autant que la virtuosité. Bien entendu, le film ne résiste pas à la tentation de s’engouffrer dans le labyrinthe des Ménines. L’historienne de l’art Araceli Guillaume-Alonso a cette belle formule : l’artiste a fait plus que représenter l’infante Marguerite-Thérèse, il a légué un « totem » à l’identité espagnole. À gauche, palette en main, Velázquez lui-même se tient dans un coin sombre de son œuvre. Dans son essai L’Eau et les Rêves, Gaston Bachelard écrivait : « Une goutte d’eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. »
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
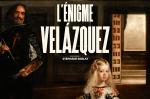
Velázquez de l’art et de l’eau
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°783 du 1 mars 2025, avec le titre suivant : Velázquez de l’art et de l’eau







