Patrick Grainville admire le peintre mais privilégie la forme littéraire de son ouvrage et ses réflexions personnelles à la psychologie du personnage.

Un cavalier galope dans la campagne et la femme qui l’attend « halète de joie ». Voilà un début de roman portant la marque de fabrique de l’académicien français Patrick Grainville, connu pour son goût des scènes érotiques. Avec cette biographie de Théodore Géricault (1791-1824), il tient un bon sujet. Le peintre est un « romantique de la première génération », son cheval « se cabre à ravir » et sa maîtresse l’imagine gravissant au galop l’escalier du château, comme dans les téléfilms : « Elle aurait entendu le souffle de l’animal forcé, le gémissement de ses muscles, un tonitruant fracas de bottes, de bride, de jarrets, de sabots, de mors cliquetant dans la bouche tiraillée, blanchie de bave. » S’interrogeant sur ce que peut être un fracas de jarrets, le lecteur se demande s’il n’est pas tombé par erreur sur une mauvaise comédie romantique. Cette ouverture aborde d’emblée l’aspect le plus romanesque de l’artiste, son amour coupable pour l’épouse de son oncle. Mais Grainville accorde moins de place que d’autres de ses biographes au spleen qui en résultait.
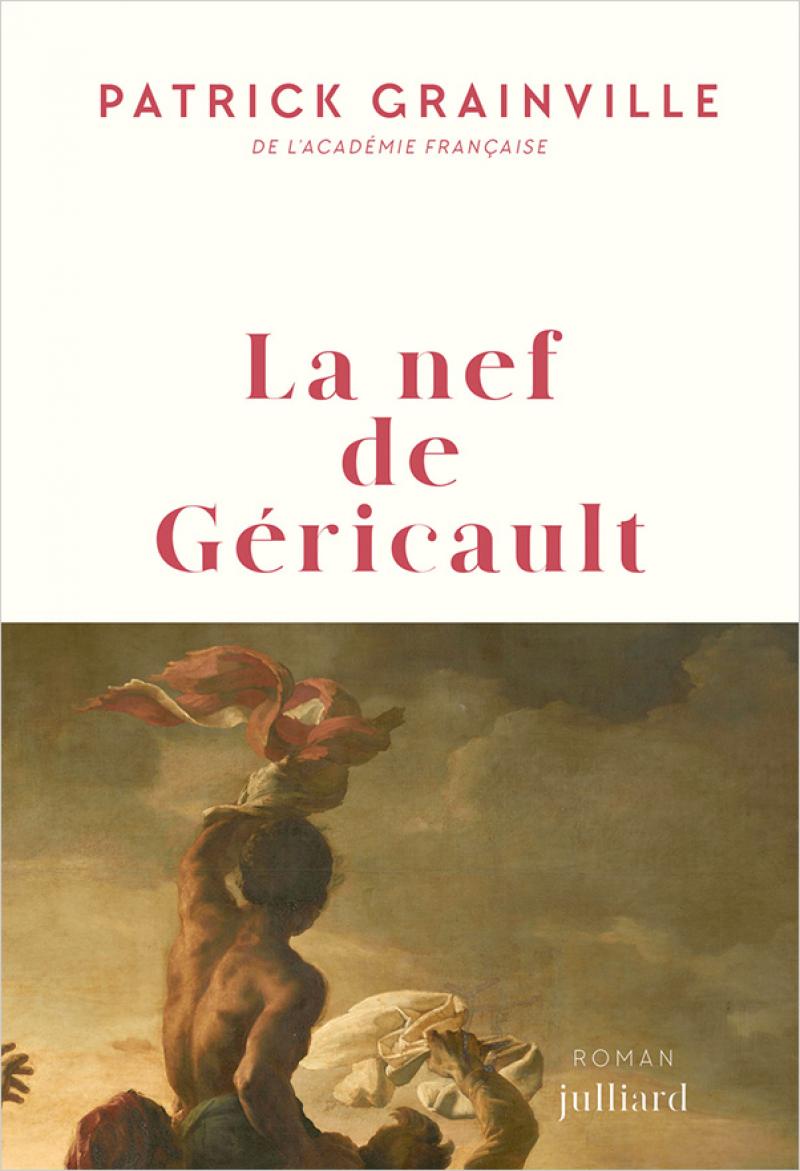
Si l’élaboration et la réception par la critique et le public du Radeau de la Méduse sont au centre du livre, c’est toute la vie du peintre qui est survolée et parfois celle du monde jusqu’à nos jours, Vladimir Poutine (« le Pou ») compris. Le tout est saupoudré de digressions sur les goûts artistiques de l’auteur. Il n’aime pas la Joconde, « bouddhique et lunaire ». Pour le XIXe siècle, outre Géricault, « un Delacroix, un Monet, un Courbet, un Manet, et ce sera ma collection privée. » Sur Horace Vernet, il reprend les poncifs de l’histoire de l’art des années 1960 et le décrit comme « l’empereur de la peinture pompeuse et pompier ». Pour montrer la révolution artistique initiée par Géricault, il ravale ses contemporains et amis au rang de pourvoyeurs en « chromos » et « clichés ». Tout au long du livre, l’écrivain apparaît ainsi davantage attaché à partager ses opinions et son érudition qu’à dresser un portrait convaincant de l’artiste.
Le plus gênant, c’est le son faux que rendent les dialogues. Le brouhaha dans l’atelier d’Horace Vernet semble sorti d’un piètre docufiction et les conversations sur la politique ou l’art du ci-devant Gabriel de La Mothe Hauclair et de la logeuse Sophie Couderc (des personnages inventés) laissent pantois : « Je suis fasciné par Géricault […]. J’aime son amour des chevaux très insistant. Ces beaux animaux frissonnants, à la crinière tempétueuse, avec leurs volumineuses fesses obscènes. Le Cuirassier ! Quel programme de charme… »
Sophie Couderc accompagne Géricault et Delacroix lors d’une visite au Louvre pour voir Léonidas aux Thermopyles et L’Enlèvement des Sabines de David, puis L’Embarquement pour Cythère de Watteau. Un épisode affligeant, où l’on discute de la taille des fesses masculines chez David, et d’ailleurs anachronique puisque, jusqu’en 1826, les deux premières œuvres ne se trouvaient pas au Louvre mais au Luxembourg. Le livre refermé, il n’en reste que le souvenir d’une scène qui pourrait lui servir d’exégèse : on y voit un papillon voletant dans la chambre de Géricault agonisant.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Un rendez-vous manqué avec Géricault
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°652 du 28 mars 2025, avec le titre suivant : Un rendez-vous manqué avec Géricault








