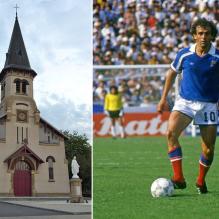LYON
Atypique et populaire, le Musée des Confluences de Lyon, qui célèbre son 10e anniversaire, est devenu une institution emblématique de la ville, inspirante en France comme à l’étranger.
C’est un musée interdisciplinaire dont les expositions répondent à un principe narratif. Le bâtiment lui-même, qui est un geste architectural fort, est devenu un emblème régional, d’autant que sa position à la confluence du Rhône et de la Saône lui donne une grande visibilité. Il fait aujourd’hui partie de l’identité de la métropole.
Nous proposons des sujets en équilibre entre les sciences naturelles et l’ethnographie, en intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux. Le parcours permanent, qui est l’identité d’une institution, est réaménagé sans cesse, selon les retours de notre observatoire du public. Nous essayons de raconter le grand récit de l’humanité, selon trois grands axes : l’organisation des sociétés humaines, les échanges et la création. À l’horizon 2027, nous souhaitons réinventer l’exposition permanente autour de la question : comment vivre en société ? S’agissant des expositions temporaires, elles durent dix mois et se superposent les unes aux autres.
Nous nous sommes rendu compte que le public cherche plus de cohérence, qu’il a envie de voyages et d’échappatoires, et qu’il y a une demande de propositions à destination des enfants, d’où notre nouvel espace « Le Nuage des petits ». Nos manifestations hors-les-murs, dans une trentaine de lieux de la métropole, sont très appréciées. En revanche, même si nous avons un public très jeune (55 % des visiteurs ont moins de 30 ans), en partie parce que nos tarifs sont très accessibles (23 € pour un pass annuel), nous ne décelons pas de demande accrue pour ce qui est numérique. Je dirais même que c’est le contraire. En dix ans, nous avons aussi effectué un gros travail de documentation et de traçabilité des objets de nos collections, et nous ne sommes pas trop confrontés aux demandes de restitutions. Nous mettrons d’ailleurs en ligne un portail destiné à ce sujet en juin. Nous avons également, pendant toutes ces années, tenu à régler les problèmes du démarrage, liés aux conditions de travail de nos prestataires, et avons accru les exigences de notre cahier des charges en la matière.
Je crois que nous avons réussi à créer un modèle inspirant. Nous valorisons ainsi notre expertise, notamment par du conseil pour d’autres projets ou institutions dans le monde, comme la Cité archéologique de Montréal. Nous ne souhaitons pas labelliser un autre lieu, comme l’ont fait le Louvre ou le Centre Pompidou, mais plutôt favoriser l’itinérance de nos expositions à l’international. L’idée est d’augmenter notre autofinancement, qui est aujourd’hui de 30 %, dont 70 % de billetterie. L’idée est de moins dépendre de la subvention publique, qui, on le sait bien, risque de stagner ou de baisser pour un certain nombre d’institutions culturelles et les rendre fragiles. Nous voulons poursuivre notre aventure sur des bases solides.
3,5 millions
C’est le nombre d’objets appartenant aux collections du musée. La majeure partie est conservée au Centre Louis-Lortet, de l’autre côté du Rhône, qui a bénéficié d’un agrandissement en 2024, avec au total 1 880 m2 de réserves.
708 965C’est la fréquentation annuelle du musée en 2024 (en progression de 5,6 % par rapport à 2023), soit une moyenne de 2 209 visiteurs par jour sur 321 jours d’ouverture. C’est le musée le plus fréquenté de France après les grands établissements parisiens.
« Le Musée des Confluences est devenu un grand musée français en très peu de temps. Il est considéré à un niveau d’excellence rarement égalé dans sa catégorie. » Bruno Maquart, président d’Universcience, 2021.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Hélène Lafont-Couturier : « Nous essayons de raconter le grand récit de l’humanité »
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°783 du 1 mars 2025, avec le titre suivant : Entretien : Hélène Lafont-Couturier : « Nous essayons de raconter le grand récit de l’humanité »