PARIS
Le philosophe Michel Guérin mène une réflexion sur l’histoire de la création artistique et la confronte à son rôle dans le temps et son époque.

Auteur d’une trentaine de livres, le philosophe Michel Guérin mène une œuvre de réflexion philosophique singulière, bien difficile à réduire à une famille de pensée repérée comme à une exclusive discipline. Une œuvre cependant qui s’est très souvent attachée au travail et au sens de l’art (la littérature comme les beaux-arts) et à la figure de l’artiste. Avec Le temps de l’art, anthropologie de la création des Modernes, Michel Guérin parcourt de grandes échelles historiques de l’art, mais non dans la manière dont les historiens construisent des continuités, des passages, des moments. Il affirme avoir « mené l’enquête dans un esprit archéologique » (p. 16), par sondage, par carottage même, avec une grande liberté de circulation dans des moments choisis dans l’histoire de l’art – la Renaissance, la modernité baudelairienne, jusqu’à nous, qui relevons désormais d’une époque postmoderne. On pourra regretter que le livre s’arrête, comme il l’annonce en sous-titre, aux portes du contemporain. Mais le souffle long de l’histoire est précieux pour mesurer les mouvements et transformations qui l’animent.
La thèse de départ n’est pas nouvelle par elle-même : c’est celle qui voit à l’échelle des siècles l’art se séculariser, se défaire de ses transcendantaux, de son arrimage à la puissance divine, de son lien à la nature et au grand récit de l’histoire. Et bientôt, romantisme aidant, l’art s’autonomise en se recentrant sur soi et emporte jusqu’à la rigoureuse auto-réflexivité du modernisme, défendue en particulier par le critique américain Clément Greenberg, jusqu’au risque d’assèchement ; ou encore s’avance sur la voie de la réduction radicale, balisée par Duchamp. Mais l’esprit de Michel Guérin lui fait dépasser la question de l’enfermement formaliste ou de la réduction conceptuelle que l’histoire de l’art connaît bien, en contextualisant les formes de l’art dans un cadre plus large. Il précise qu’« on ne saurait comprendre le modernisme à l’intérieur d’une vision étroitement limitée à l’histoire de l’art, ni même comme un phénomène purement idéologique donnant le ton d’une époque. Il concerne une multitude de dimensions de la réalité sociale – travaillée par des transformations spectaculaires contrastant avec le monde ancien qui s’éclipse sans totalement disparaître » (p. 304). Et de conclure non tant à l’échec du modernisme, mais par l’assertion que « dans un sens plein, il a fait son temps » (p. 306), c’est-à-dire qu’il a rempli sa fonction historique, et non qu’il a accompli tout ce qu’il a promis, comme on répond à un cahier des charges. Les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle n’ont pas à être mesurées à l’accomplissement de leur programme, mais bien plus à leur capacité d’avoir en leur temps permis un élargissement des conceptions et fait se déplacer les possibles de l’art.
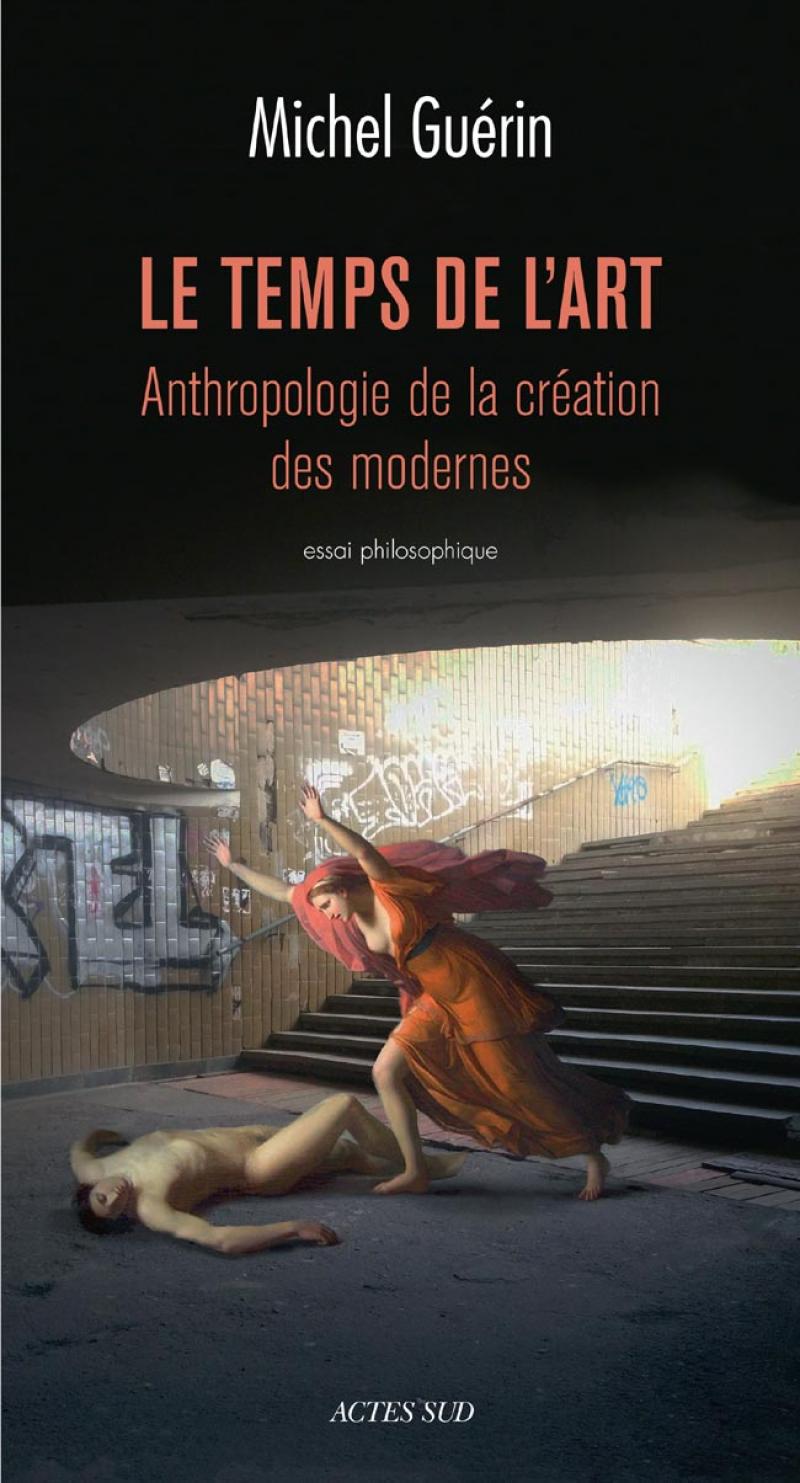
Une mutation positive
Cette vision dynamique de l’art en son histoire, résolument non essentialiste, dessine la position positive de l’auteur. Si le mouvement moderne est bien un processus de réduction, Michel Guérin va cependant le décrire sans la nostalgie qui s’y attache souvent, quand la réduction moderniste est lue – par la pensée communément conservatrice surtout – comme deuil sans fin, aboutissant à enfermer l’art dans un paradis d’avant, à tout jamais perdu et irréparablement regretté.
L’auteur construit, et son lecteur avec lui – s’il le suit dans quelques quatre cent pages denses –, une pensée de la perte positive. Aussi le philosophe peut-il affirmer : « L’art est ce qui reste, non seulement quand on a oublié les dieux et les temples, mais quand on oublie l’art lui-même » (p. 14). Cette négativité n’est pas prise comme un fait regrettable, comme un péché inconsolable, mais comme le propre de l’appartenance à l’histoire des faits et formes de l’art. La question est autrement formulée quelques lignes plus loin : « Un art athée est-il possible ? » (p. 15). Mais la réponse tient à cette perspective en mouvement que construisent ces pages : l’art y apparaît comme moyen de résister à la faillite, y compris en prenant en compte sa propre faillite ; l’art y est pris comme puissance, comme « ambition ».
C’est l’art comme devenir qui intéresse Guérin, non par une bienveillance naïve, mais par un attachement profond à l’historicité des choses de l’art. Car « ayant pris son parti d’être sans cosmos, l’art s’est consolé d’avoir perdu le contact avec la Nature et avec l’Histoire en s’inventant une histoire à lui, purement à-venir et guidée par un orient aussi excitant qu’indéterminé» (p. 17). Ainsi Guérin se refuse au « diagnostic catastrophiste quant à la santé de l’art au stade actuel » (p. 18). Il préfère souligner cette puissance de l’art et chevaucher la perspective anthropologique portée par son sous-titre dans la mesure où la pensée de l’art n’est pas seulement théorique, mais inclut aussi la dimension de l’expérience des œuvres, de leur réception et des transformations permanentes des horizons d’attente du spectateur. Le temps de l’art, nous fait penser Guérin, n’est plus celui des essences stables, mais celui de la transformation permanente et réciproque des conceptions artistiques et de la réception publique de l’art, des enjeux des œuvres et de l’horizon d’attente des spectateurs, pris dans le mouvement des époques.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

L’ambition de l’art
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°512 du 30 novembre 2018, avec le titre suivant : L’ambition de l’art








