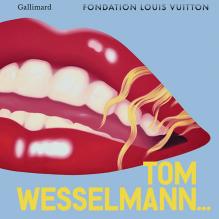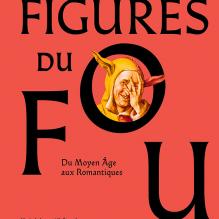Paru aux éditions Gourcuff Gradenigo, l’ouvrage passionnant de Doïna Lemny explore les relations sentimentales de Constantin Brancusi et, ce faisant, démêle le vrai du faux et l’amitié de l’amour. Une enquête sur un cœur.
Constantin Brancusi (1876-1957) est une machine à fantasmes. Les trois syllabes de son nom auront cristallisé de nombreuses légendes. Celle du berger des Carpates venu bouleverser la Ville Lumière en lui inoculant le goût du primitivisme. Celle de l’indocile élève quittant l’atelier du maître Auguste Rodin au prétexte que « rien ne pousse à l’ombre des grands arbres ». Celle du génie reclus dans sa thébaïde, loin du monde. Si ces légendes dorées, souvent apocryphes, furent entretenues par Brancusi lui-même – fervent mythographe –, de nombreux exégètes, parmi lesquels Doïna Lemny, spécialiste affûtée de son compatriote, ont tenté de dissiper les ombres et d’approcher – pour paraphraser l’un des précédents livres de l’historienne de l’art, également publié aux éditons Gourcuff Gradenigo – « la chose vraie ».
Singulier, ce nouvel opus étudie le royaume amoureux de la vie du grand homme, ainsi que l’explicite sa note programmatique : « Adoré et même vénéré par toutes les femmes qui ont franchi son atelier, Brancusi est resté dans les souvenirs de ses amis comme un grand séducteur, sujet de désirs amoureux. » Quelles furent donc les affinités électives et sentimentales de l’auteur de tant de baisers et de Princesse X (1915-1916) ?
D’ample format (20,3 x 28 cm), cet ouvrage broché de 176 pages accueille sur sa couverture deux photographies éloquentes. En première, une image argentique, réalisée vers 1927, représente la jeune danseuse Marthe Lebherz, scrutant les yeux de Brancusi, dont les mains de charpentier dessinent silencieusement dans l’air des figures. Ce suaire de la passion dialogue significativement avec la quatrième, une photographie figurant l’artiste seul dans son atelier, irrésistiblement seul, comme absorbé par ses pensées quoique flanqué de deux dessins du Baiser, quand un être vous manque et que tout est dépeuplé.
Chaque rabat abritant le détail d’une lettre – en ouverture, les phrases enflammées que Marina Chaliapine adressa en 1937 au maître roumain, en fermeture celles d’Eileen Lane, rédigées dix ans plus tôt –, toutes les typologies archivistiques sont convoquées d’entrée, manière d’attester la prodigalité d’un royaume des sentiments où Brancusi trône en souverain, mais en souverain souvent déchu, en roi sans divertissement qui n’aura jamais réussi à s’établir durablement dans l’amour, lui qui livrait pourtant des œuvres à l’éternité.
Intitulé « Des muses inspiratrices et des muses protectrices », l’essai liminaire de Doïna Lemny, roboratif, rappelle combien Brancusi, qui déclarait volontiers que « l’amour est la plus grande escroquerie », fut « adulé » par les femmes. Partant, cette introduction, en sondant chronologiquement la vie sentimentale de l’artiste, met au jour le déchirement foncier qui l’articule : amant ardent, Brancusi est épris d’indépendance. Il veut – aimer –, mais il ne peut pas. Et quand il veut pleinement, l’autre se dérobe. Dans les années 1920, la Suissesse Marthe Lebherz, avec sa grâce de tanagra et ses trente années de moins, embrase Brancusi, quinquagénaire, qui conçoit bientôt l’aporie amoureuse à laquelle le contraint sa création. Dans les années 1930, la pianiste anglaise Vera Moore, à laquelle il confie être « comme devant un premier amour », lui qui se croyait « à jamais guéri », donne naissance en 1934 à un enfant que l’artiste ne reconnaît pas, comme s’il eût été impossible d’avoir un fils et d’enfanter des œuvres par dizaines. D’une paternité strictement… esthétique.
Cet ouvrage soigné, auquel on reprochera quelques scories dommageables (ainsi du substantif « gent » écrit à plusieurs reprises avec un « e »), se déploie sous la forme d’un répertoire des muses qui, amies ou amantes, auront traversé la vie de Brancusi, auquel on ne connaît nul commerce sentimental avant son arrivée à Paris. À force de documents savoureux, les 14 séquences – consacrées à la somptueuse Florence Meyer ou à la sagace Marina Chaliapine – permettent d’approcher les histoires complexes d’un artiste manifestement moins avide d’être aimé que d’être entouré – par des femmes, par des regards, par une aura.
Feinte négligence ou dilemme insoluble ? La réponse se trouve assurément du côté des sculptures, qui métabolisent artistiquement les affinités électives de Brancusi : Margit Pogany devient ainsi une effigie synthétique de la volupté (1912-1913), la poétesse Nancy Cunard, une Jeune Fille sophistiquée (1928) et la collectionneuse Léonie Ricou, un totem primitif (Madame L.R., 1914-1917). Totem et tabou, la femme est chez Brancusi un objet de désir assurément obscur. Qui se souvient que le modèle de Princesse X (1915-1916), ce phallus souverain, serait un portrait de Marie Bonaparte, princesse et traductrice de Freud, auteure de travaux pionniers sur la sexualité féminine ? D’un sexe l’autre. Du continent noir au fétiche doré…
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
« Brancusi et ses muses », de Doïna Lemny
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°763 du 1 avril 2023, avec le titre suivant : "Brancusi et ses muses", de Doïna Lemny