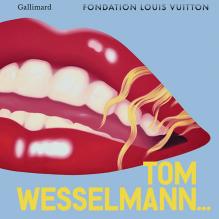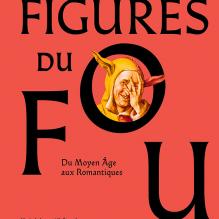Président-directeur honoraire du Louvre, aujourd’hui président du comité d’orientation scientifique du futur Institut national de l’histoire de l’art (Inha) en cours d’installation dans les anciens locaux de la Bibliothèque nationale, Michel Laclotte commente ses choix pour la « Bibliothèque idéale » du Mai du livre d’art, soit environ trente-cinq ouvrages publiés avant 1998 et après 1993.
Pourquoi avoir accepté de lancer cette “bibliothèque idéale” ?
Par pure vanité ! Ma sélection comprend des “monuments”, tels que La Divine Comédie illustrée par Botticelli (Éd. Diane de Selliers), quelques “gros” livres comme Les peintres de Sienne (Motta-Imprimerie nationale) et Fresques italiennes de la Renaissance 1400-1510 (Citadelles & Mazenod), écrits par de vrais spécialistes de la question, mais également des livres de poche. J’ai avant tout choisi des textes de “première main” : soit des livres traitant sérieusement un sujet pour la première fois (Corneille de La Haye dit Corneille de Lyon par Anne Dubois de Groër, chez Arthena ; Les orfèvres parisiens de la Renaissance 1506-1620 par Michèle Bimbenet-Privat, édité par Paris-Musées), soit des ouvrages comme le livre de Daniel Arasse sur Léonard de Vinci (Hazan) ou celui de Philippe Morel sur les Grotesques (Flammarion), qui sont le fruit d’une longue réflexion sur le sujet ou des sujets voisins, parallèles, complémentaires. Je n’ai pas hésité non plus à inclure des livres épuisés afin d’encourager les éditeurs à les réimprimer.
Votre sélection comprend beaucoup de catalogues.
Les Français, qui ne sont peut-être pas de grands historiens de l’art, sont en revanche de grands visiteurs : le catalogue d’une même exposition se vend mieux à Paris qu’à Londres ou à New York. En trente ans, le catalogue est devenu un livre d’art. Il comporte désormais davantage d’essais introductifs, très nécessaires pour cadrer le sujet, et, à côté des notices érudites, beaucoup plus d’illustrations. Non seulement les œuvres exposées sont toutes photographiées, parfois en détail, mais les œuvres de comparaison sont également incluses. Devenus de véritables monographies, les tirages s’envolent et permettent de vendre à des prix raisonnables… au désespoir des éditeurs, incapables de proposer les mêmes contenus aux mêmes prix.
Quels thèmes avez-vous souhaité privilégier ?
L’histoire du goût, c’est-à-dire l’évolution de la pratique de l’histoire de l’art, des collectionneurs et du marché… à laquelle se sont intéressés notamment Francis Haskell (L’Historien et les images, Gallimard), Max Friedlander (De l’art du connaisseur, Livre de Poche, à réimprimer) ou Antoine Schnapper (Curieux du grand siècle, les collections d’art en France au XVIIe siècle, Flammarion). J’ai également souhaité mettre en avant le travail des éditeurs de province (Sainte Cécile d’Albi, sculptures, Odyssée), pour rappeler que tout ne se passe pas uniquement à Paris. Pour preuve, les beaux catalogues Visages du grand siècle, le portrait français sous Louis XIV (Somogy), Prague 1900-1938, capitale secrète des avant-gardes (RMN, épuisé) ou Félix Duban, les couleurs de l’architecte (Gallimard/Electa) : trois expositions qui n’ont été montrées qu’en province.
…et quels auteurs ?
J’ai voulu donner un coup de chapeau rétrospectif à Rudolf Wittkower (Qu’est-ce que la sculpture ? Éd. Macula) et Richard Krautheimer (Rome, portrait d’une ville, Livre de poche), qui furent chassés de l’Allemagne nazie et qui donnèrent, avec quelques autres comme Gombrich, un coup de fouet formidable à l’histoire de l’art en Angleterre et aux États-Unis. Deux vieux sages, dans la grande tradition germanique de l’histoire de l’art où se sont illustrés Riegl, Warburg, Saxl, Panofsky… Le Krautheimer est sorti directement en poche en 1999, “hors limites” donc, mais c’est le résumé de toute une vie. Le Wittkower est publié chez Macula, un éditeur qui se donne du mal et qui, comme Gérard Montfort, a permis à la France de rattraper un retard important dans la traduction des grands textes de notre discipline.
Avez-vous des regrets ?
J’aurais voulu inclure davantage de livres de photographies, tels que le catalogue de Sylvie Aubenas consacré à l’Art du nu au XIXe siècle, le photographe et son modèle (Hazan/BnF) : tout le monde avait été frappé par cette exposition qui était très neuve. J’aurais aimé trouver un livre sur le XXe siècle qui ait le poids du Matisse de Pierre Schneider. Du fait des limites temporelles, je n’ai pu sélectionner le Cimabue de Bellosi, l’Histoire de l’architecture du XIXe siècle par François Loyer, le très beau catalogue de l’exposition Man Ray, les photos de Victor Hugo en exil, le catalogue de l’exposition Mansart…
Quelles sont les grandes étapes de l’histoire de l’édition du livre d’art ?
Pour les “beaux livres”, Skira a été le premier, dès les années quarante, à utiliser brillamment la couleur. Comme aujourd’hui à propos des nouvelles technologies, les gens disaient à l’époque : “C’est trop beau, les gens n’iront plus au musée” ! Puis vint la période Gallimard, avec Malraux – dont je suis un grand défenseur à tous égards – et l’importance donnée à la mise en relation des images entre elles. J’ai d’ailleurs salué comme il se doit l’Univers des formes, qui est aujourd’hui, hélas, une collection morte, en choisissant Une époque en rupture de Werner Hoffmann. Il faut aussi rendre hommage aux éditeurs italiens des années soixante, Fabbri et Rizzoli, et à leur volonté de vendre en kiosque des livres relativement bon marché. Ils ont fait preuve d’une imagination et d’une invention formidables en associant des images de qualité à des textes de première main : je les ai tous conservés !
Quel serait l’exemple à suivre en matière d’édition de livres d’art ?
Trouver du mécénat pour aider à la publication d’ouvrages difficiles à publier. Comme le fait la Fondation de France : elle a de l’argent à y consacrer, elle a trouvé quelques titres, mais n’a pas encore d’éditeur… sauf pour la traduction du Krautheimer. L’Inha peut servir de courroie de transmission et de garantie à ce type de projet.
Le mot de la fin ?
J’ai choisi l’Introduction à l’histoire de l’art français (Champs/Flammarion) par André Chastel, qui se clôt par ces mots : “le léger voile de mélancolie de qui est blessé par la fuite du jour”. Aussi beau que la fin de la Recherche, non ?
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
La « vanité » de Michel Laclotte
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°104 du 28 avril 2000, avec le titre suivant : La « vanité » de Michel Laclotte