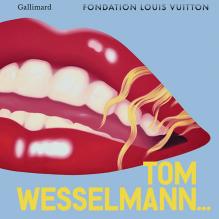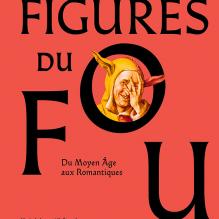Qu’est-ce que la mer fait aux artistes, écrivains et peintres ? Splendide, l’ouvrage des éditions Citadelles & Mazenod, loin de la morne compilation, élabore des affinités non électives et, avec, une réponse. Poétique, donc.
Promesse infinie, promesse d’infini, la mer est une machine à fantasmes. Métonymie de l’ailleurs et du lointain, elle ouvre des perspectives et autorise des projections. Avec le ciel, son double spéculaire, la mer encourage les récits et, depuis la nuit des temps, engendre des héros (Noé et Ulysse), des divinités (Poséidon et Vénus) et des créatures (sirènes et néréides). Calme avant la tempête, d’huile ou de feu, la mer fascine par sa mobilité et son instabilité, ainsi que l’attestent les écrits païens et les Écritures saintes, les allégories antiques, les envolées hugoliennes ou les fulgurations rimbaldiennes.
Les peintres le savent également, eux qui n’eurent de cesse de gagner les îles, les falaises et les plages pour observer le chahut de l’immensité et, ce faisant, les abîmes intérieurs. C’était une gageure, donc, que de pouvoir faire dialoguer le noir de la plume et la couleur du pinceau : spécialiste des rapports entre littérature et peinture, Daniel Bergez parvient à élaborer de subtiles conversations plastiques, inoculant au lecteur le goût de relire et le désir de revoir. Et ce n’est pas rien.
Intimidante, cette épaisse publication de 512 pages se distingue par son grand format (29 x 35 cm), conforme aux beaux livres publiés par la prestigieuse maison d’édition, ainsi que par son élégance. En effet, cet ouvrage relié, avec son dos toilé, tire avantage d’un beau coffret dont le plat, figurant le manuscrit emblématique de Vingt Mille Lieues sous les mers (1868-1869), est percé d’un large oculus ménageant une trouée sur l’illustration de la première de couverture – un détail de Saint-Tropez, le port au soleil couchant, opus 236 (1892) par Paul Signac.
En d’autres termes, peinture et littérature viennent d’emblée entremêler leurs lignes afin de composer une image qui, hybride, résume à elle seule le projet intellectuel du livre. La quatrième de couverture est, quant à elle, une reprise de l’autre plat du coffret, à savoir un détail de la Nuit d’été (1890) de l’Américain Winslow Homer, ce formidable nocturne mélancolique que l’État français acheta dès 1900 lors de sa présentation à l’Exposition universelle. Manière de rappeler que la mer, loin de n’être qu’un délassement nautique, est aussi l’espace des joies et des peines, le décor silencieux des tréfonds de l’âme.
L’ouvrage se déploie selon cinq séquences chronologiques (Antiquité, Moyen Âge et Renaissance, Âge classique, XIXe siècle puis XXe siècle), chacune d’elles abritant un corpus de textes qui, sans relever spécifiquement de la littérature hexagonale – trahissent naturellement une inclinaison française. Cette articulation chronologique, au détriment d’un parcours thématique apte à souligner des persistances et des fraternités, eût été scabreuse si la sélection n’avait été irréprochable. Les grands textes sont là, de Pline à Camus en passant par Rabelais, Shakespeare, Goethe, Andersen et Proust.
Certes, la littérature contemporaine est réduite à peau de chagrin, incarnée par les seuls Alessandro Baricco, Marie Darrieussecq et J.M.G. Le Clézio ; certes, Yukio Mishima est curieusement absent de cette anthologie. Il n’en demeure pas moins que ces regrets de bon aloi, symptomatiques des ouvrages stimulants dont on eût aimé qu’ils comblassent absolument tous nos rêves, sont consolés par les présentations extrêmement fines qui, liminaires aux quelque cent trente textes réunis, introduisent l’auteur et caractérisent son tropisme marin afin de rendre tous ces morceaux choisis fluides, voire nécessaires.
Élément liquide matriciel, voire maternel, la mer sait être diabolique. Avec ses ondes maléfiques, avec ses lames, ses doubles lames, la mer est le pays des métamorphoses et des engendrements, des transformations et des dissolutions. Sexuelle, sensuelle, envoûtante ou morbide, tout y est sublime, cette « terreur délicieuse » selon le philosophe anglais Edmund Burke.
Grâce à une photogravure extrêmement soignée et à une sélection particulièrement congruente, les images sont bien plus que de simples illustrations, elles viennent redoubler le plaisir du texte et créer une dilection synesthésique, la peinture permettant toujours d’exhausser la littérature, à moins que ce ne soit l’inverse. À cet égard, les couples Clément Marot/William Turner, Lautréamont/Emil Carlsen, Fernando Pessoa/Léon Spilliaert et Virginia Woolf/Georgia O’Keeffe permettent singulièrement de révéler les sortilèges magnétiques de cette mer qui, pareille à une « pierrerie dissoute », semble laisser entrevoir « quelque chose d’inexprimable » (Victor Hugo). Exprimer l’inexprimable : serait-ce cela écrire et peindre la mer ? Serait-ce entrevoir une promesse qui toujours se dérobe, comme la queue de la sirène ou l’écume des jours ? Question océanique.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Écrire la mer
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°735 du 1 juillet 2020, avec le titre suivant : Écrire la mer