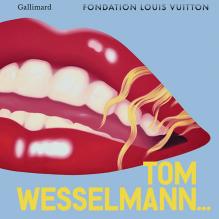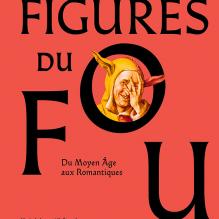Coédité par Fage éditions et la Fondation Giacometti, l’ouvrage consacré à l’exploration giacomettienne du corps, et particulièrement du nu féminin, est aussi élégant que délicieux. Décryptage d’une hantise scopique.
Contrairement à une idée reçue, l’inflation de la glose, si elle développe notre connaissance, élargit le mystère, car ce que l’on prenait pour un petit rébus à décrypter participe toujours d’un réel sibyllin. Plus on écrit, plus l’énigme s’accroît. Cette dérobade du monde à mesure qu’on l’approche est, du reste, un principe cardinal de la phénoménologie giacomettienne : « Plus je regardais le modèle, plus l’écran entre sa réalité et moi s’épaississait. »
Face à cette épistémologie sisyphéenne, certains auraient pu renoncer, baisser les bras, laisser à d’autres le soin de mener bataille. Or, depuis plusieurs années, la Fondation Giacometti s’emploie scrupuleusement, et méthodiquement, à explorer une œuvre polysémique : par des expositions, évidemment, mais aussi par des publications, les secondes étant parfois adossées aux premières, comme c’est le cas pour cette publication. Avec une régularité métronomique et une exigence infrangible, la fondation parisienne s’est ainsi associée avec les lyonnaises Fage éditions pour publier des ouvrages qui, formant désormais collection, investiguent des collections et des archives souveraines. Une mission d’utilité publique, donc, et une hardiesse inestimable.
Relié, de format modeste (16,5 x 23 cm), le présent ouvrage accueille en première de couverture le détail agrandi – un torse nu, seins et nombril – d’une photographie reproduite en quatrième, laquelle représente Alberto Giacometti en 1922 à l’Académie de la Grande Chaumière, en compagnie du modèle Carmen Damedoz, pour ce qui est l’une des premières, si ce n’est la première photographie du jeune sculpteur, vingt et un ans, dans l’atelier d’Antoine Bourdelle. Décentré, l’élégant titre de l’ouvrage, en lettres dorées, et comme bronzées, laisse toute sa place à la blancheur lactescente d’un corps que viennent ombrer des seins lourds ainsi que la suggestive naissance de l’aine.
Outre cette photographie éloquente, qui semble propulser le jeune Giacometti, engoncé dans son pardessus et sa timidité, au milieu d’un monde de corps, de corps nus, la quatrième abrite la brève note d’intention d’un « ouvrage, richement illustré, [qui] permet de saisir l’évolution de la figure féminine, des premiers nus copiés d’après les grands maîtres aux célèbres Grandes Femmes des années 1960 ».
Le livre est articulé autour de trois essais, clos par deux entretiens que Giacometti accorda à André Parinaud et Pierre Dumayet, respectivement en 1962 et 1963. Signé Catherine Grenier, le premier revient sur « L’énigme de la figure nue » qui voit Giacometti fouiller obsessionnellement le corps et, de manière spéculaire, son regard. Car, déclinant des figures du même, comme un musicien varie à l’infini un leitmotiv pour parvenir à l’invariante beauté, le Suisse explore autant la nature des corps que la nature de sa vue, qui est une vision, avec ce que cela suscite de mystère, de spiritualité et d’intuition. Face au corps, face à ces corps, Giacometti ne semble-t-il pas se demander ce qui demeure quand tout change et, plus encore, ce que voir veut dire ?
Dans le deuxième essai, Philippe Büttner convoque le corpus des Femmes de Venise, que Giacometti conçut pour le pavillon français de la Biennale de Venise de 1956, et dont l’intrigante genèse ainsi que des photographies majeures prouvent combien l’artiste s’intéressa aux « corps multiples », jusqu’à parfois les superposer comme dans l’incroyable Tête et nu, peinte vers 1964.
Le troisième texte, signé Michèle Kieffer, étudie « l’inépuisable source d’inspiration » qui irrigue la hantise scopique de Giacometti, depuis le corps académique découvert chez Bourdelle jusqu’aux itérations ultimes en passant par l’expérience surréaliste.
Somme toute, qu’est-ce qu’un corps ? Pourquoi donc Giacometti s’évertue-t-il à fouiller en deux dimensions l’écheveau du corps et en trois sa folle profondeur ? Pourquoi essaie-t-il ici de comprendre ce qui distingue la vie littéralement charnelle, autrement dit carnée, de la mort squelettique, autrement dit décharnée ? Qu’est-ce qui demeure quand tout change, donc, mais aussi quand il n’y a plus rien ? Et comment comprendre cette photographie anecdotique d’un nu féminin que Giacometti crayonne à sa manière, comme pour estamper le réel d’un peu de mystère ?
C’est que Giacometti est devant le corps nu comme Œdipe devant le Sphinx : il tente en effet de résoudre l’énigme, mais une énigme insoluble, qu’est le corps non pas des femmes, mais le corps du réel. On se souviendra que le Sphinx fut le nom merveilleux d’un bordel où Giacometti alla voir et toucher des corps, pour se plonger au milieu d’un réel hiéroglyphique et assurément impénétrable. On se souviendra enfin que sa mère s’appelait Annetta et sa femme Annette. Le corps (nu) serait-il donc cela, chez Giacometti : l’objet transitionnel vers le mystère ?
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Alberto Giacometti. Histoire de corps
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°728 du 1 novembre 2019, avec le titre suivant : Alberto Giacometti. Histoire de corps