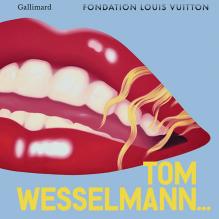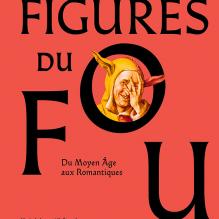L’écrivain publie chez Actes Sud un livre sur le peintre roumain Adrian Ghenie, quelques mois après avoir préfacé les Conversations de Francis Bacon (L’Atelier contemporain) et signé un roman sur Caravage (Fayard).
Je suis un amateur, un amoureux d’art. Ma femme est italienne, et nous avons longtemps vécu à Florence où, chaque jour, pour ma seule jouissance, j’allais voir les œuvres de Fra Angelico, Paolo Uccello… dont j’ai tiré le petit livre Je cherche l’Italie. Je n’ai pas de formation artistique, mais je fréquente assidûment les œuvres d’art. Au fond, ce qui me frappe de plus en plus, à 53 ans, c’est à quel point les problèmes fondamentaux de la métaphysique se jouent dans l’art. Caravage, Bacon ou Ghenie m’apportent la philosophie, l’esprit ; quelque chose qui, dans le langage, ne va pas de soi. Leur peinture me fait penser.
Après avoir terminé le roman Tiens ferme ta couronne– qui se terminait devant le retable d’Issenheim à Colmar –, j’ai fait une pause dans l’élaboration narrative du roman pour me confronter à la représentation du visible, qui me passionne. Pour moi, il s’agissait au départ de modéliser le langage pour parvenir à qualifier quelque chose qui, a priori, ne s’exprime pas : la peinture. J’ai donc accepté les commandes que l’on m’a proposées pour ces livres. Caravage, qui a déclenché chez moi une frénésie de phrases, a mis en jeu quelque chose d’un rapport spirituel à la peinture – la peinture de Caravage étant une tension entre Dyonisos et le Christ, entre le païen et le catholique. Pour Adrian Ghenie, cela a été d’un autre ordre : je ne connaissais pas sa peinture, mais le commanditaire [Harry Jancovici, ndlr] était l’éditeur du texte écrit par Deleuze sur Bacon, il y a quarante ans. Je me suis dit, modestement, que j’allais me mesurer à ce texte : savoir comment un écrivain pouvait, aujourd’hui, se mettre en jeu par rapport à la peinture qui, par définition, lui échappe. Nous n’avons pas beaucoup parlé avec Adrian Ghenie, lorsque je suis allé le voir dans son atelier à Berlin, mais j’ai compris tout de suite que sa peinture provoquait chez moi quelque chose qui ne demandait qu’à éclore.
Vous avez raison, c’est sans doute de la critique d’art. J’ai beaucoup d’admiration pour ces mots, comme pour les textes de Bernard Lamarche-Vadel que j’ai connu avant son suicide. Je me suis dit que le territoire de la critique d’art devenait un lieu où mes fictions théoriques pouvaient se déployer. J’ai commencé à me raconter une histoire à partir des tableaux de Ghenie, en me disant que son geste consistait peut-être à briser la porte du château dans lequel Goering, qu’il a peint, entassait les œuvres spoliées par les nazis, et à leur rendre leur liberté.
J’ai tendance à défaire les genres lorsque j’écris. Il me semble que j’ai écrit le texte sur Ghenie à la manière d’un roman spéculatif quand, à l’inverse, mes romans prennent parfois la forme d’un essai. Il y a d’ailleurs des moments où j’emploie le « je » dans le texte. Pour moi, il n’y a pas de forme plus appropriée qu’une autre pour parler d’art, la meilleure étant celle qui parvient à mobiliser le langage. Si j’emprunte l’apparence d’une monographie avec Adrian Ghenie, Déchaîner la peinture, c’est au fond un livre de littérature. J’aime Proust lorsqu’il parle de Rembrandt et de Chardin, Artaud lorsqu’il s’empare volcaniquement de Van Gogh, Bataille lorsqu’il écrit sur Manet… Je me sens très proche de leur liberté et j’assume de n’avoir pas tout à fait le vocabulaire requis pour parler d’art.
Ce qui me le permet ? Mon outrecuidance personnelle ! Sa violence chromatique m’a sauté à la figure. Ghenie a fixé quelque chose que j’ai d’abord rejeté. Son travail sur les visages m’a été insupportable avant de voir qu’il m’excitait intellectuellement et de comprendre que ses gueules « cassées », muselées ou « masquées », étaient comme une expertise des atteintes que la mutation génétique opère sur nos visages. C’était comme si Ghenie me révélait par la peinture là où nous en sommes dans notre rapport à la figure humaine. Dans sa peinture qui s’ouvre à tous les cauchemars du XXe siècle (Hitler, Mengele, Staline, Ceausescu…), il y a une réflexion sur la politisation, insupportable, du visage. J’ai retrouvé quelque chose de la série Twin Peaks de David Lynch dans sa peinture, qui relève d’une révolution quantique de la représentation, à savoir : où en sommes-nous de la disparition de l’incarnation ?
J’ai d’abord noirci jusqu’à épuisement des pages de petits cahiers Clairefontaine de fragments de textes, de réflexions, pendant que je consultais frénétiquement des catalogues, que je détaillais les œuvres. Ensuite, j’ai recomposé ces fragments en leur donnant un ordre, en approfondissant des idées, en relisant Lyotard et en allant voir longuement le tableau de Ghenie conservé à Beaubourg. Le livre s’est construit par jaillissements, sans savoir si Ghenie souscrit à ce que je vois dans sa peinture : un monde où l’Histoire elle-même est le démon.
Je pense qu’il n’y a pas plus digne d’intérêt – à l’exception de l’Amour ! – que le mal pour comprendre l’infigurable. Ce qui m’intéresse dans cette lignée de peintres, c’est la vérité d’un monde qui est en proie au démon. Les visages enregistrent les bouleversements plastiques qui affectent le monde : ceux de Bacon enregistrent les soubresauts des « boucheries mondiales » du XXe siècle, quand ceux de Ghenie montrent les mondes des laboratoires et des sciences – obscures – qui nous tiennent en otage.
L’hiver dernier, j’ai eu la chance d’être enfermé une nuit dans l’exposition Bacon du Centre Pompidou, et je suis en train d’écrire un livre sur Bacon pour la collection « Une nuit au musée » chez Stock.
Cela a été pour moi, pendant près de trois ans, un laboratoire qui va sans doute relancer mon écriture, la galvaniser à neuf. J’aime le jaillissement d’écriture que m’a offert la rédaction de ces livres, et qui n’a pas le côté fastidieux de la construction d’un roman.
Se laisser travailler par la peinture, c’est être face à l’art de l’impossible, comme disait Bacon à David Sylvester. Cela m’a poussé dans mes retranchements. Il n’y a pas de triche possible dans la critique d’art : l’art est un défi lancé à la littérature. Si je parviens à transmettre quelque chose face aux tableaux de Ghenie, alors cela déclenche de la littérature.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Yannick Haenel : "L’art est un défi lancé à la littérature"
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°735 du 1 juillet 2020, avec le titre suivant : L’art est un défi lancé à la littérature