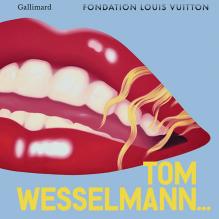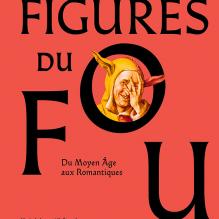En quête d’un Orient sensuel ou biblique, les peintres anglais ont laissé libre cours à leur imagination.
Tandis que l’ouvrage de référence de Christine Peltre, Les Orientalistes, vient d’être réédité chez Terrail, les Éditions littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble proposent la compilation des articles de Laurent Bury, professeur de littérature anglaise du XIXe siècle à l’université Lumière Lyon-2. L’Orientalisme victorien dans les arts visuels et la littérature décrypte le travail des artistes britanniques ayant fait route vers l’Orient dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Du Maghreb à l’Inde, l’auteur revient sur les traces de la quête d’un Orient sensuel et d’un Orient biblique, deux entités antinomiques nées de l’interprétation de peintres qui ont bien souvent inventé ce qu’ils ont prétendu représenter. Comme tant d’autres, John Frederick Lewis (1804-1876) a multiplié les incursions imaginaires dans l’univers des harems. À l’argument mythologique qui a déshabillé des siècles de peinture, succède l’argument ethnographique, nouvelle autorisation à lever le voile sur la nudité. L’authenticité de ces odalisques de sérail n’en est pas moins illusoire et c’est le public qui, consentant bien volontiers à la supercherie, guide le pinceau de l’artiste. La représentation des harems par Lewis évolue au gré des scandales que suscite son œuvre : d’un écrin polygame où règne la concupiscence à une structure proche de la famille bourgeoise victorienne, il a façonné un Orient sur mesure, plus ou moins épicé selon le palais de ses consommateurs. Face à la pudibonderie britannique affirmée, beaucoup d’artistes se tournent vers l’art religieux. Sous une ère marquée par la révolution industrielle, on assiste à un nouvel élan mystique dans la peinture. Les préraphaélites William Holman Hunt (1827-1910) et Thomas Seddon (1821-1856) effectuent en Terre sainte un retour aux sources géographiques de la Bible. Leurs périples sur les lieux s’accompagnent d’un voyage dans le temps auxquels ils croient, souvent en toute bonne foi, se livrer. « L’Égypte est pleine de sujets bibliques et on trouve une Sainte Famille dans chaque village arabe », s’enthousiasme le peintre David Roberts (1796-1864), pensant rencontrer en Orient un peuple demeuré inchangé depuis deux millénaires.
Cet ouvrage universitaire à petit budget souffre d’un manque d’illustration des œuvres décrites qui oblige le lecteur à de fréquentes incursions sur Internet. Il n’en est pas moins rythmé par de passionnants témoignages d’artistes peu connus du grand public : de Richard Dadd, qui dans ses crises de folie se croyait poursuivi par Osiris, à Val Prinsep qui s’adonnait en 1877 à la chasse aux radjahs pour les immortaliser sur une toile diplomatique à destination de la Couronne britannique. La voix des artistes se fait entendre à travers des citations brutes, livrant un vif aperçu de la mentalité d’une époque victorienne particulièrement engoncée dans ses préjugés racistes. Il est évident que les œuvres orientalistes en disent plus sur ceux qui les ont conçues que sur les sociétés qu’elles se sont évertuées à représenter.
LAURENT BURY, L’ORIENTALISME VICTORIEN DANS LES ARTS VISUELS ET LA LITTERATURE, Éditions littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble, coll. « Vers l’Orient », 2011, 248 p., 28 euros, ISBN 978-2-8431-0176-2
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Un Orient sur mesure
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°342 du 4 mars 2011, avec le titre suivant : Un Orient sur mesure