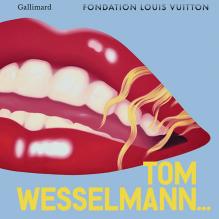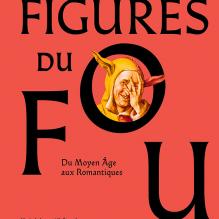Dans son dernier ouvrage intitulé « Le Spectateur émancipé », l’auteur interroge l’efficacité de l’art sur de multiples champs.
Le petit monde des conversations artistiques et des tables rondes aime à se donner des noms et des mots mana, de ces mots « joker » qui rehaussent la parole des saveurs de la théorie. C’est là un bonheur, parfois bien (trop) commode, de la citation et de la référence et autre name-dropping [liste de noms]. Il y a ainsi un « effet Deleuze », qui a fait de quelques mots clefs du philosophe des passe-partout – un « pli » ici, un zeste de « société de contrôle » là, un rab de « rhizome » et une bonne dose de « déterritorialisation ». Ainsi l’un des récents noms « mana » est-il celui de Jacques Rancière, qui pointe régulièrement au détour du débat critique et que l’on entend souvent au gré d’une actualité soutenue de ses publications. Ses ouvrages récents ont des intitulés opportunément programmatiques (Le Partage du sensible, Le Destin des images, Le Spectateur émancipé pour son dernier) et d’autant plus précieux que la pensée de Rancière n’est ni simple ni uniforme, résistant par là à la réduction à quelque formule magique et consensuelle. Si, depuis une dizaine d’années, Rancière a orienté son travail philosophique vers les questions esthétiques, il n’en a pas pour autant produit une théorie systématique. Il sera sans doute plus juste de parler d’un travail d’essayiste, en donnant toute sa valeur à cette forme de l’écriture théorique. Celle-ci emprunte avec Rancière tour à tour la grande échelle de l’histoire des idées et des idéologies (du XVIIIe siècle au nôtre, en passant par les fondations grecques de la pensée philosophique et par l’histoire sociale moderne, dont celle du XIXe qu’il parcourt depuis plus de vingt ans) et l’analyse critique d’œuvres contemporaines. La question politique dans l’esthétique est donc au centre du livre Le Spectateur émancipé, considéré sous plusieurs angles : car l’« efficacité » de l’art s’y trouve interrogée sur des plans multiples, tant au travers du dispositif de sens que produit la relation esthétique et celle qui s’instaure entre le spectateur, l’œuvre et l’artiste, que des intentions de l’artiste ou les grands substrats idéologiques de traditions esthétiques modernes. Rancière bataille avec les enjeux plus ou moins implicites de celles-ci, et leurs illusions. Où se fonde l’idée moderne commune que l’art peut et doit être édifiant, libérateur, subversif ? L’espace agencé, physique et symbolique de la mise en scène et de la salle du théâtre fournit un terrain d’observation de la relation de l’œuvre au spectateur, un terrain d’analyse des rapports d’autorité qui s’y engagent. Rancière prête aux auteurs et aux héritages esthétiques modernes le présupposé de la passivité du spectateur, là où lui, tenant du retournement critique, veut reconnaître à cette figure une compétence et une responsabilité actives.
Trois fonctionnements
Ainsi les œuvres à ambition politique révèlent-elles plus que les autres encore le spectateur qu’elles présupposent, dans la mesure où elles prétendent à une efficience précise. Rancière identifie brillamment celle-ci, en distinguant trois régimes de fonctionnement symbolique : « le régime esthétique, en opposition au régime de la médiation représentative et à celui de l’immédiateté éthique » (p. 64). Dans le premier, l’art propose une « forme d’expérience propre », différente des autres expériences sensibles, déterminant l’art comme une sphère de vie spéciale, séparée. Le deuxième, sous le mode de la fiction, dévoile l’écart, le « dissensus » entre le visible et sa signification. Dans le troisième, c’est la conscience éthique du spectateur-citoyen qui est engagée. Mais chacun de ces régimes s’adresse au « je ». Comment le propre du politique, le « nous », pourrait-il s’y retrouver ? La tradition de l’art critique, dont les avant-gardes du XXe siècle sont le modèle, a cru pouvoir associer les trois régimes pour conduire à la mobilisation politique. Mais le paysage politique qui est le nôtre, où le principe de consensus tend à remplacer le débat contradictoire, coupe court à ce décollement du monde et de sa représentation, laissant à l’acquiescement, à l’adhésion au spectaculaire la part belle. Sur quel point de partage ou de séparation entre art et vie peut compter aujourd’hui l’artiste ? L’activisme artistique inscrit au cœur des pratiques sociales est menacé de disparaître en tant qu’art, tandis que l’art demeurerait dans son cercle d’efficacité restreint. Sauf à déplacer, comme le fait Rancière, cette dualité fatale, en décrivant le politique et le monde comme des champs de représentation. « Le rapport de l’art à la politique n’est-il pas le passage de la fiction au réel mais un rapport entre deux manières de produire des fictions ? » (p. 84)
Le troisième chapitre – « L’image intolérable » – interroge le document, le statut de visibilité et les schémas stratégiques selon lesquels il se fait œuvre. Quand le quatrième et dernier chapitre – « L’image pensive » – poursuit, lui, l’exploration fine des « rapports entre pensée, action, art et image » (p. 128) et les niveaux de sens qu’elle produit. Il n’est pas aisé de réduire ce Rancière-là à un titre. Il vaut mieux que cela, discutant et discutable, plus inspiré par la patience critique que par l’autorité théorique.
Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, éditions La Fabrique, Paris, 2008, 150 p., 13 euros, ISBN 978-2-91-337280-1.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Rancière émancipateur
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°296 du 6 février 2009, avec le titre suivant : Rancière émancipateur