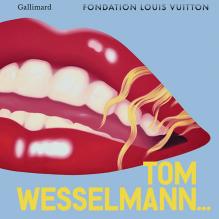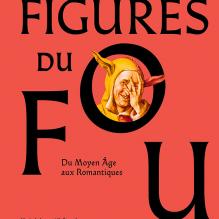Face au retour à l’ordre qui s’amorce, il est urgent, à la suite d’Olivier Quintyn dans son récent essai, de défendre un art exigeant qui n’en aurait pas pour autant renoncé à son rapport à la vie et au social.

Le modèle historique de la modernité a installé au centre de la pensée de l’art la figure de l’avant-garde. La notion concilie l’exigence du nouveau, la promesse du progrès et son urgence. Ruptures, émancipations, affranchissements, la lecture historiciste de l’art occidental nourrit le thème, dès le XIXe siècle ; quant au temps des avant-gardes revendiquées, des années 1910 aux années 1930, où cohabitent des pratiques si divergentes que Dada et les constructivismes, c’est un moment court mais déterminant. Désormais, la notion d’avant-garde est structurante pour la pensée de l’histoire. Mais en même temps, elle aura usé son crédit comme moteur artistique assumé.
De violentes récusations
Au XXIe siècle, le concept de progrès dans l’art ne fait plus guère recette, même si le nouveau et l’originalité demeurent des exigences partagées. Les avant-gardes historiques ont toutefois rencontré elles-mêmes de forts moments de résistance, de rappel ou retour à l’ordre, portés bien souvent par des acteurs et personnalités venus d’horizons idéologiques extérieurs au champ de l’art, voire à celui de la « culture cultivée ». Elles se sont trouvé en butte à de violentes récusations, jusqu’à être radicalement menacées en tant qu’« art dégénéré » et à devenir objet de destruction par le nazisme. Elles ont été ignorées face aux dogmes figuratifs de l’art, dans les pays socialistes notamment, et souvent désavouées, congédiées par un large champ de la pensée politiquement réactionnaire – comme il est de nouveau de mise dans le paysage politique français d’aujourd’hui. Le populisme qui y vitupère produit une menace concrète sur la liberté de création. Il réclame un art nécessairement régional, artisanal et patrimonial, et énonce sans fard son intention de soumettre un appareil institutionnel culturel public à une « politique culturelle du beau, de l’agréable, de l’harmonie, de l’esthétique et de l’enracinement, respectueuse de la nature humaine et des valeurs civilisatrices », en croyant pouvoir dénoncer une actuelle « “culture” [considérée comme] élitaire, abstruse, laide, subversive, provocatrice, vide, cosmopolite, conformiste et politiquement correcte… » (extraits, ainsi que le texte qui suit, du « blog.cneea.fr/public/000-lettres/ARA-Boudot.pdf »). Cet antagonisme définit des critères d’éligibilité au soutien public, dans un clair déni de démocratie porté par un candidat d’extrême droite aux récentes élections régionales, pour qui seuls peuvent se revendiquer comme de « vrais artistes » ceux qui « en retrouvant le soutien populaire […] retrouveront en même temps leur place dans la société ». Il est devenu vital de ne pas laisser à la voix du pire la question de la place sociale de l’art et de sa relation à la vie, question centrale des théories des avant-gardes.
C’est en tout cas la thèse du philosophe allemand Peter Bürger dans son essai presque déjà classique Théorie de l’avant-garde (1), thèse que reprend et prolonge de manière consistante l’essai d’Olivier Quintyn intitulé Valences de l’avant-garde. Conçu au départ comme une postface à l’édition française du livre de Bürger, l’essai court et dense engage un réexamen de l’avant-garde comme concept artistique, dépliant l’héritage théorique auquel Bürger prend part (notamment l’école de Francfort, avec Theodor Adorno et Jürgen Habermas), et tente d’actualiser celui-ci. La question initiale de la contradiction structurante des avant-gardes entre élitisme et vie sociale, autrement dit de l’autonomie de l’art et de son mouvement contraire de dispersion dans la vie, aboutit chez l’auteur allemand au constat que l’institutionnalisation des pratiques artistiques est devenue un piège. Ceci « en vertu de l’aporie logique selon laquelle la coupure de l’art par rapport à la vie, dont celui-ci a pourtant besoin pour critiquer l’existant, est aussi du même coup sa fausseté [p. 43] », résume Quintyn.
Aussi est-ce par une interrogation légitime du fonctionnement de l’institution et de l’institutionnalisation artistique que l’auteur prolonge la réflexion sur l’avant-garde. Il examine en particulier les stratégies artistiques dites de « critique institutionnelle », au-delà de la part déjà historique prise par Fluxus et la performance, en référence à Michael Asher, à Art & Language… ou aux Yes Men. Comment cependant l’art pourrait-il maintenir son horizon éthique, « porter la trace bouleversante de l’hétéronomie et de la souffrance sociale [p. 43] », sans se faire symptôme ou illustration et perdre sa force d’œuvre, sans se voir neutralisé par la fétichisation marchande et/ou muséale ? Les développements qui s’ensuivent considèrent le concept d’avant-garde comme un concept opératoire, comme un « analyseur ». Il s’agit de dépasser la contradiction de la récupération-neutralisation dans le contexte général du post-capitalisme tardif, quand nombre de phénomènes du monde de l’art alimentent cette neutralisation, parmi lesquelles les Biennales et les foires, mises en scènes du marché. Mais aussi en tâchant d’échapper au remake spectaculaire des néo- et néo-néo-avant-gardes incorporées, qui se contentent trop facilement d’une critique du simulacre.
Sur le terrain social
Le deuxième chapitre va donc chercher à vérifier l’hypothèse de pratiques dites « transinstitutionnelles », qui tentent le prolongement de la critique institutionnelle vers tous les champs de la vie commune, en s’attachant à des pratiques précises, celles par exemple proposées par les collectifs travaillant sur le terrain social, dans des interstices. Des œuvres qui relèvent d’un « médium incertain », partagées entre production symbolique et activisme. Et tentent de déjouer les apories de l’art politique en créant des connexions entre les acteurs, en déplaçant sinon dépassant la question de l’esthétique.
Le troisième chapitre – le débat y est plus spécifique et pointu – met en discussion la manière dont la pensée philosophique et critique issue de la tradition analytique envisage la spécificité du « monde de l’art » : elle nourrit in fine le conservatisme institutionnel, pointe l’auteur.
C’est au contraire en inventant et en mettant en œuvre des possibilités d’expérimentation institutionnelle dans des champs de vie et de savoir hétérogènes que demeure l’esprit constructif de l’idée d’avant-garde, sa dimension « affirmative », comme en écho à Herbert Marcuse – cité par Quintyn – quand il parle du caractère affirmatif de la culture. Un caractère que bon nombre de nos politiques ne semblent pas ou plus porter dans leurs préoccupations.
(1) publié en 1974, traduit en français en 2013 (lire le JdA no 395, 5 juillet 2013) et objet de nombreuses relectures aujourd’hui en Europe et aux états-Unis.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Pour une avant-garde affirmative
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Olivier Quintyn, Valences de l’avant-garde, essai sur l’avant-garde, l’art contemporain et l’institution, 2015, éditions Questions théoriques, collection « Saggio Casino piccolo », 168 p., 9 €.
Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°449 du 22 janvier 2016, avec le titre suivant : Pour une avant-garde affirmative