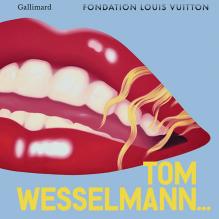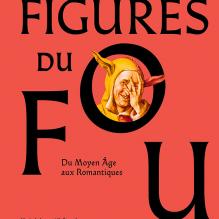Le critique et historien d’art américain Michael Fried a choisi Adolph Menzel pour conclure sa série d’essais sur le réalisme esthétique. Longtemps dénigré par les théoriciens modernistes, le peintre allemand se voit enfin réhabilité parmi les grands maîtres du XIXe siècle.
Il y a un siècle, l’influent critique d’art Julius Meier-Graefe avait tendance à placer les artistes allemands au même niveau que leurs contemporains français, pourtant considérés comme plus avancés. Il avait réservé un sort plus ambigu au peintre Adolph Menzel (1815-1905). D’une part, il voyait ses peintures dites “privées” de la fin des années 1840, des esquisses à l’huile de son propre appartement et du quartier avoisinant de Berlin, comme de remarquables anticipations de l’impressionnisme français. Même si ces peintures n’ont fait surface qu’autour de 1900, le critique était convaincu que si Adolph Menzel avait persévéré dans cette veine moderniste, l’art allemand aurait pris de l’avance sur l’art français. D’autre part, il dénigrait les œuvres plus tardives, auxquelles il reprochait une surcharge de détails et d’anecdotes pour devenir, dans certains cas, de simples tableaux historiques. L’art allemand venait de rater une grande occasion.
La déception de Julius Meier-Graefe a influencé les défenseurs de la cause moderniste de l’époque. Le critique d’art britannique Roger Fry, par exemple, a réduit les dessins d’Adolph Menzel au statut de “purs calques mal illustrés”, alors que nombre d’entre eux sont de véritables tours de force techniques d’une grande étrangeté et originalité. Que l’art d’Adolph Menzel ait été, d’une certaine manière, exclu du canon moderniste – d’autant plus que ses peintures ne sont visibles que dans des collections allemandes – explique la réception tardive du peintre dans le monde anglo-saxon.
Des descriptions détaillées
La rétrospective consacrée à l’artiste à la National Gallery de Washington en 1996 a contribué à un regain de faveur. Michael Fried a vu en cette exposition la chance d’étudier de plus près ces peintures ; quatre-vingt-dix-sept ans après la mort du peintre, l’historien d’art signe aujourd’hui la première monographie en anglais sur l’artiste allemand. Adolph Menzel ne pouvait espérer un spécialiste plus érudit. Michael Fried consacre depuis longtemps ses recherches à la peinture réaliste, avec notamment d’importants travaux sur Gustave Courbet (1) et Thomas Eakins (2). Ce troisième volet conclut ainsi sa “trilogie sur le réalisme XIXe siècle, où il réitère et affine les arguments précédemment développés.
À l’instar des meilleurs critiques d’art, Michael Fried sait avant tout décrire les peintures de manière inspirée. Certains des passages les plus vivants sont de longues descriptions détaillées de chaque tableau et de chaque dessin ; le chapitre VII est ainsi consacré à la dissection minutieuse de trois des plus importantes peintures dites “privées”. Le critique tire un plaisir évident à observer soudainement, dans une peinture, un petit pan de mur qu’il n’avait pas vu, et à s’adonner à une analyse passionnante sur la façon dont ce détail si minuscule “s’insère” dans l’ensemble de la peinture.
Inlassablement, le lecteur est un peu plus captivé, convié à observer des aspects inaperçus du tableau et à établir de lui-même de nouveaux liens. L’analyse de Michael Fried est toujours originale, pour ne pas dire consciemment provocante. Il soutient, par exemple, que la gouache Le Prince héritier Frederick rend visite au peintre Pesne sur son échafaudage à Rheinsberg (1861) – d’un style rococo qui faisait bondir les détracteurs modernistes du peintre – est une “véritable allégorie” de l’art aussi complexe et rigoureuse que L’Atelier du peintre de Gustave Courbet (1855). Cet argument réside au cœur du travail de Michael Fried.
Il s’efforce en effet de démontrer que la virtuosité technique éblouissante d’Adolphe Menzel est mise au service d’une intelligence subtile et raffinée. Qu’il dépeigne Frédéric le Grand au château de Sans-Souci, les cadavres purulents des généraux prussiens exhumés ou un palier d’escalier, cette intelligence s’inscrit entièrement dans son époque et sa situation géographique, autrement dit, le Berlin du temps de son essor impérial.
Présence détectable
Michael Fried tente de trouver une manière de “regarder” l’art d’Adolph Menzel qui concilie les esquisses de la vie moderne avec les scènes historiques, les allégories avec les œuvres les plus banales, l’ampleur de son usage de la peinture avec le caractère obsessionnel de certains travaux tardifs. À cet effet, l’historien décrit le concept principal de l’“incarnation” dans la peinture d’Adolph Menzel. À l’inverse de l’impressionnisme français, l’art d’Adolph Menzel n’est pas essentiellement optique – la comparaison avec ce courant est en l’occurrence, comme le montre Michael Fried, inadéquate. Ses réalisations sont marquées de sa propre présence, que l’on peut à la fois voir et ressentir. Témoin visible, car il s’inclut physiquement dans ses œuvres. Témoin détectable dans le rapport avec son propre corps selon le médium qu’il utilise, mais aussi dans son travail de composition qui joue avec la multitude de points focaux de l’œuvre. Il faut parfois admettre que son désir de tout décrire était si intense – comme dans certaines des dernières gouaches, représentant la vie sociale de Berlin – que l’image globale devient à peine perceptible à travers la myriade de détails et finit par nous égarer.
Curieusement, Michael Fried établit des liens forts entre Adolph Menzel et son contemporain, Søren Kierkegaard, en particulier avec le Ou bien... Ou bien... (Gallimard, 1984) de l’auteur. Armé de nombreuses comparaisons probantes, Michael Fried soutient que les observations mordantes de Søren Kierkegaard, bien que vivant et écrivant à Copenhague, trouvent un écho dans les représentations d’Adolph Menzel. Dans une étude sur la tradition esthétique allemande, d’Emmanuel Kant et Friedrich Schiller à Hans-Georg Gadamer et Theodor Adorno, Kai Hammermeister identifie également Søren Kierkegaard à un personnage captivant, et souligne le caractère paradoxal de son travail. En effet, même si la pensée esthétique est au cœur de sa philosophie, il a toujours considéré l’esthétisme avec dédain.
Tout comme l’étude superbement illustrée de Michael Fried, ce volume sera également un outil précieux pour l’initiation aux aspects centraux de l’art et de la pensée allemande du XIXe siècle, un champ plutôt négligé jusqu’à présent.
(1) Le Réalisme de Courbet, Gallimard, 1993
(2) Realism, Writing, Disfiguration : On Thomas Eakins and Stephen Crane, University of Chicago Press, 1988
Michael Fried, Menzel’s Realism : art and embodiment in XIXth century Berlin, New Haven et Londres, éd. Yale University Press, 2002, 313 p., 70 ill. couleur, 100 ill. n&b, env. 53 euros. ISBN 0-300-09219-9
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Menzel avec réalisme
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°164 du 7 février 2003, avec le titre suivant : Menzel avec réalisme