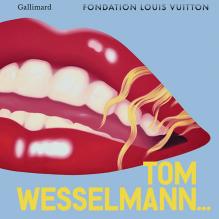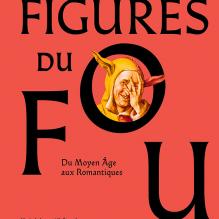Les soubresauts en matière de politique culturelle ont souvent été féconds.
Et si les situations de crise étaient salutaires pour la culture ? Telle est la thèse proposée par Antoine de Baecque, historien de la culture et des Lumières et ancien animateur de la rubrique culture du quotidien Libération. La filiation avec Hannah Arendt – évidente dès le titre, Crises dans la culture française – est assumée. En 1954, l’Américaine exprimait son désarroi face à l’arrivée de la culture de masse dans un ouvrage resté célèbre (La Crise de la culture, sa portée sociale et politique). Antoine de Baecque partage un même sentiment : comment démocratiser la culture sans la massifier ? Car pour l’auteur, la source profonde des crises qui ont jalonné la culture en France réside dans son incapacité à remplir son objectif de démocratisation culturelle, « juge de paix de toutes les politiques culturelles depuis le début du XXe siècle ». L’ouvrage défend pourtant les vertus de la crise comme thérapie. « Qu’est-ce qu’une crise ? écrit l’auteur. C’est l’inadéquation qui éclate, qui brise, qui jaillit et dans ses éclats même ouvre un moment de retour sur soi, un temps de réflectivité et de réflexion ». Comment ne pas admettre que le chaos révolutionnaire a permis la création du principe de musées et la définition de la notion de patrimoine, fondement de notre politique culturelle moderne ? Ce, après des siècles de privatisation par le clergé et la noblesse.
L’ouvrage est donc un long constat désenchanté, à la plume parfois acide, plaçant, en bon historien des Lumières, le théâtre au cœur de la définition des politiques culturelles. Le fil se déroule depuis l’Ancien-Régime jusqu’à l’arrivée d’un président Sarkozy décidément bien à son aise dans ce climat de panne culturelle. Il écorne non sans plaisir les icônes du ministère de la Culture.
Une « pythie sans crédits »
Dans ce long processus, Antoine de Baecque, identifie cinq grandes crises. Après la mise à l’épreuve par la Révolution de la culture régalienne qui avait généré centralisation et artistes officiels – mais qui restera pourtant profondément ancrée dans la tradition française –, vient en effet l’échec de la « mystique du peuple » exaltée par l’éphémère politique culturelle du Front populaire. La création d’un ministère d’État chargé des affaires culturelles en 1959 n’aura pas non plus les effets escomptés. L’excessif André Malraux – qualifié de « névrosé » –, s’il a jeté les bases d’une nouvelle administration de la culture, n’aura été qu’une « pythie sans crédits », selon la formule du critique d’art dramatique Gilles Sandier. Mais surtout, sa vision d’une culture appréhendée par la sensibilité et le choc esthétique a rapidement montré ses limites pour la conquête d’un public le plus large possible.
L’autre figure de la Rue de Valois est évidemment le sémillant Jack Lang. L’auteur est peu amène avec son bilan : quels que soient les moyens accordés au ministère de la Culture, le fossé entre le peuple et la culture n’a cessé de se creuser depuis 1981. Le triplement du budget par le ministère Lang n’a abouti, selon les statistiques fournies par la Rue de Valois, qu’à une érosion croissante des pratiques culturelles. Conscient de son impuissance, Jack Lang aurait promu « le tout culturel », c’est-à-dire mettre de la culture dans tout à défaut de parvenir à faire de la culture pour tous, enrobant l’ensemble dans une communication oiseuse et un caractère festif qui ont fini par écœurer jusqu’à ses thuriféraires de la première heure. Peu inspirés, ses successeurs n’ont fait ensuite que se réfugier derrière la bataille pour l’exception culturelle française, « pansement sur une jambe de bois », repoussant encore la refondation de la politique culturelle française tant attendue. La dernière crise, et non des moindres, identifiée par Antoine de Baecque est celle du 21 avril 2002 qui a vu arriver le Front national au second tour de l’élection présidentielle. « Un peuple qui peut dire oui à Le Pen est un peuple qui se fout que la culture disparaisse », écrivait Philippe Val dans Charlie Hebdo. Le constat dépasse alors celui du simple échec de l’accès à la culture : celle-ci provoque désormais un sentiment de rejet. L’espoir est pourtant né de deux crises. Celle des intermittents, replaçant la question sociale au centre de la politique culturelle, puis celle de l’édition 2005 du festival d’Avignon, qui a vu s’affronter anciens et modernes autour d’une programmation hardie avec Jan Fabre en guest star. La controverse dans l’art était enfin de retour. Depuis, la machine est toujours en panne. Le nouveau locataire de l’Élysée l’a bien compris, appelant de ses vœux l’art à l’école et les médias comme vecteurs de la démocratisation culturelle. Il est raillé par l’auteur qui voit pourtant dans « l’art à l’école [la] figure de proue de l’innovation et de l’ambition en matière de politique culturelle », et appelle de ses vœux une union avec l’Éducation nationale. Car déjà, les annonces présidentielles ont accouché d’une souris (lire Le JdA n°273, 17 janvier 2008). L’art à l’école attendra encore, même si la politique culturelle continue à s’éroder dans un nouveau climat de recherche de rentabilité.
Antoine de Baecque, Crises dans la culture française, éd. Bayard, 2008, 249 p., 19 euros, ISBN 978-2-227-47684-4.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Les vertus de la crise
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°278 du 28 mars 2008, avec le titre suivant : Les vertus de la crise