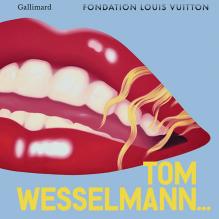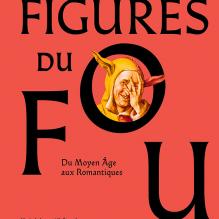Ébouriffant, le livre que Pauline Mari réserve à l’accouplement du cinéma et de l’op art se distingue par sa profondeur intellectuelle, attentive à l’histoire des idées, comme par sa langue, fluide et ensorcelante. remarquable.
C’est Une Thèse. une thèse de doctorat, soutenue en 2016 à l’université paris iv-sorbonne. une thèse scientifique, pleine d’idées et de fulgurances, présidée par le discernement et la clairvoyance. une thèse qui voit son auteure examiner, inventorier et déchiffrer les prolongements filmiques du cinétisme afin d’y voir vraiment clair. si les amours morganatiques entre le cinéma et les beaux-arts ont fait l’objet de plusieurs publications récentes explorant les spécificités plastiques ainsi que les déploiements illusionnistes du septième art (cinéma, création et recréation, les impressions nouvelles, 2018, et stéréoscopie et illusion, presses universitaires du septentrion, 2018), la présente publication se concentre sur les rapports œdipiens entre le cinéma et l’op art, qui enfantèrent dix années durant deux figures esthétiques majeures, et presque pathologiques – respectivement le voyeur et l’halluciné. du reste, pauline mari l’exprime sans détour : « à travers paris, londres et rome, cet ouvrage retrace une histoire de passeurs de l’art aux névroses accordées. » un ouvrage comme une cure, donc.
De Format Presque carré (17 x 21 cm), ce livre broché de 268 pages se plie, par sa couverture ivoirine que zèbre le profil énigmatique d’un œil vert d’eau, aux signes graphiques distinctifs de la collection « le spectaculaire », éditée par les presses universitaires de rennes et dirigée de main de maître par véronique campan et gilles mouëllic – la rencontre (2007), le miroir et le simulacre (2015) et filmer la peau (2017). subtile, la première de couverture héberge un photogramme issu de la decima vittima (1956) de elio petri. vénus botticellienne, dont le décoiffé et les épaules nues avouent la feinte pudeur, ursula andress paraît détrônée par un tondo adapté de l’artiste grazia varisco : la pin-up semble comme chassée de son lit par cette inquiétante icône de l’op art, par cette « présence cinétique » faisant effraction dans sa chambre vide et dans son intimité profanée.
D’une Efficacité redoutable, cette image résume à elle seule le constat exprimé par les lignes programmatiques de la quatrième de couverture, lesquelles décèlent dans l’op art la « victime consentante » d’un cinéma fasciné par cette « esthétique hallucinée, apte à sublimer un décor à moindres frais, apte à traduire des états mentaux délirants, ou des visions impossibles ».
Intitulée « Mouvement », l’exposition de la galerie denise rené, en 1955, sacre l’art cinétique de victor vasarely. quelques années plus tard, l’europe entière puis les états-unis, où naît la locution abréviative d’op art (pour « optic art »), tremblent et trépident devant cette « géométrie euphorisante », avec ses rayures, ses cibles et ses damiers, toutes ces formes pulsatiles qui peuplent bientôt les dressings, saturent les publicités et investissent les images jusqu’à leur agonie pour cause de surexposition, au seuil des années 1970.
Assurément, Les Artistes du grav (acronyme du « groupe de recherche d’art visuel », fondé notamment par françois morellet, julio le parc et jean-pierre yvaral), à défaut d’émanciper les foules, libérèrent les « pulsions et les affects que l’œil cultivé avaient maintenus sous cloche » (arnauld pierre) et perçurent dans le cinéma, cette machine à visions, un partenaire de premier choix. détrônant « l’abstraction lyrique et gestuelle de hans hartung et de georges mathieu, qui mythifie des émotions singulières », l’op art ambitionnait de parler au plus grand nombre et sursollicitait comme jamais la pulsion scopique. comment le cinéma pouvait-il négliger ce fraternel héraut de l’éros rétinien ?
Jacques Doniol-valcroze confiant à une sérigraphie de vasarely le rôle de chamade hypnotique (le viol, 1968), joseph losey intégrant les œuvres vibratiles de bridget riley dans une fresque dont le syncrétisme scabreux le dispute au sadomasochisme (modesty blaise, 1966), pasquale festa campanile situant un libertinage vengeur dans un décor cliniquement cinétique, avec ses stries rayonnantes et son halo lumineux (la matriarca, 1968) : par une scansion tripartite (« paris, le bourgeois s’émancipe », « londres, la vieille espionne », « rome, la mue du voyeur ») et par un chapitrage affûté (« le boudoir et la geôle », « le bestiaire de stendhal »…), l’historienne de l’art affronte avec fièvre et sans crainte un corpus cinématographique tout à la fois polymorphe et extravagant.
L’exercice Aurait pu virer à la compilation filmique ou à l’énumération typologique. or, en dépit de la fascinante hétérogénéité des œuvres convoquées, pauline mari parvient à organiser une odyssée tout à la fois savante et accessible, servie par une iconographie profuse et, plus encore, par une souveraine écriture, capable d’habiter les nuances et d’éconduire les lieux communs. un livre électrique et vibrant. voyant et hallucinant.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Le voyeur et l’halluciné
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°716 du 1 octobre 2018, avec le titre suivant : Le Voyeur Et L’halluciné