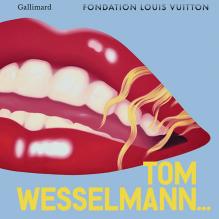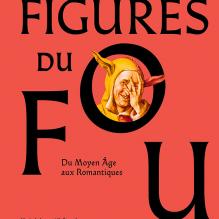Deux ouvrages réexaminent le projet émancipateur de l’avant-garde à la lumière de l’art contemporain. Tandis que deux autres explorent la méthode de Debord ou le modèle cinématographique comme art de la mémoire.
La question est aussi ancienne que l’idée même d’une « histoire de l’art », de la conscience de l’historicité de l’art : peut-on, doit-on, concevoir un progrès en art ? Les ambitions de la modernité reposaient sur une telle certitude, cette certitude qui porta plus loin encore les avant-gardes historiques. Mais l’histoire (de l’art mais pas seulement) n’est pas linéaire, ou pas seulement linéaire. Elle se fait par déplacements d’enjeux réflexifs, qui empruntent aux arguments et aux outils de la philosophie et de l’esthétique théorique. C’est d’après Adorno et les propositions de l’école de Francfort, appuyées sur l’héritage de la pensée marxiste, en discutant aussi Walter Benjamin ou Jürgen Habermas que le philosophe allemand Peter Bürger rédige sa Théorie de l’avant-garde, un classique paru en 1974 en Allemagne et traduit aujourd’hui par les soins de Jean-Pierre Cometti. L’auteur y fait le constat d’échec des avant-gardes historiques (constructivisme, surréalisme) à réaliser leur objectif : faire sortir l’art de l’un ou l’autre des champs socioculturels spécifiques dans lesquels il s’est trouvé enfermé, capté, selon les moments de l’histoire occidentale.
Le livre permet surtout d’interroger notre contemporanéité et la difficulté de rendre crédible le rôle émancipateur de l’art. Les avant-gardes historiques voulaient rapprocher l’art de la vie pratique. Elles n’y sont pas parvenues alors qu’à son tour l’art des années « contemporaines » s’est trouvé encapsulé, malgré, selon Bürger, des tentatives de dépassement comme la performance dans la sphère close de l’« institution art ». Bürger produit là une critique active de l’art contemporain, en ce que celui-ci rejoue l’avant-garde mais sans parvenir, sinon sans chercher, à sortir de soi-même. Et qu’il demeure toujours aussi loin de la « vie pratique ». Mais il laisse allumée, certes en veilleuse, l’idée d’un art nécessaire. Seuls Beuys et l’Internationale situationniste assurent « une perpétuation conséquente du projet de l’avant-garde dans une époque qui a cessé de lui être favorable (p. 177) ». Et pourtant l’« institution art » se montre vorace vis-à-vis de l’héritage « situ », et en particulier de Guy Debord : ses archives ne sont-elles pas désormais considérées comme « trésor national », comme le rappelle l’introduction au catalogue de l’exposition de la Bibliothèque nationale de France (jusqu’au 13 juillet) ? L’institution s’en est nourrie très largement pour former Guy Debord, un art de la guerre, une monographie dense, assez canonique et bien documentée, avec de l’inédit.
Ucello et Kronenbourg
Plus resserré est La Fabrique du cinéma, volume conduit par Fabien Danesi, Fabrice Flahutez et Emmanuel Guy autour du travail cinématographique de Debord. Là aussi, le document prend une place importante, d’autant que la méthode cinématographique de Debord se fonde précisément sur l’accumulation d’images et de pages issues en particulier de la presse. Suivent 130 pages de portfolio où l’on croise pubs et stars, pin-up et cartes anciennes, Uccello et Kronenbourg, textes et photographies reproduits souvent avec les repères sur calque des recadrages pour le filmage. Le cinéma par d’autres moyens, dans son chantier. Au-delà de l’aspect un rien fétichiste, le parcours se fait exercice de lecture d’image, entre fragment et collage, entre nostalgie et acidité critique. Peter Bürger, dans son souci de l’histoire, semble s’en défier quand il note : « En dépit de toute culture de la mémoire, notre présent entretient un rapport cassé avec le passé (il se peut que la culture de la mémoire en soit précisément un indice) (p. 174). »
La question est prise à bras-le-corps par François Boutonnet dans son Mnémosyne, une histoire des arts de la mémoire de l’Antiquité à la création multimédia contemporaine. Car lui aussi entend explorer l’imaginaire de l’image, dans son rôle précisément d’outil de la mémoire, et cela en s’ouvrant à l’histoire longue. En faisant à son tour des boucles temporelles, et mettant en contact cet art de la mémoire inventé par les Grecs (p. 8) et le principe cinématographique. Ou comment relire l’image comme cœur du théâtre de la mémoire, aussi bien sous les formes traditionnelles de la représentation scénique que comme cadrage-montage, comme collage sur le modèle cinématographique, voire dans son existence numérique. Et de réfléchir à la manière dont nos mémoires numériques changent à leur tour l’édifice de la mémoire. « Les arts numériques, en redonnant vie à la philosophie de Giordano Bruno, redécouvrent cette conception ancienne de l’art comme processus magique, et ravivent l’antique vocation de Mnémosyne, ce rêve enfoui d’un monde transformé par la vision conjointe de la mémoire, de la poésie et de l’action (p. 120). » La magie, laquelle peinerait sans doute à trouver sa place au sein d’une histoire dialectique !
Peter Bürger, Théorie de l’avant-garde, traduit de l’allemand par Jean-Pierre Cometti, 2013, éditions Questions théoriques, collection « Saggio Casino », 192 p., 18 €.
François Boutonnet, Mnémosyne, 2013, éditions Dis Voir, 128 p., 22 €.
Guy Debord, Un art de la guerre, collectif sous la direction d’Emmanuel Guy et Laurence Le Bras, 2013, coéd. BNF/Gallimard, 224 p., 39 €.
F. Danesi, F. Flahutet, E. Guy, La fabrique du cinéma de Guy Debord, 2013, Actes Sud, Arles, 172 p., 29 €
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Le progrès de l’art et les boucles de la représentation
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°395 du 5 juillet 2013, avec le titre suivant : Le progrès de l’art et les boucles de la représentation