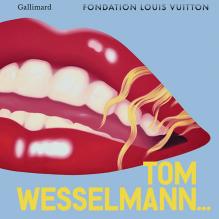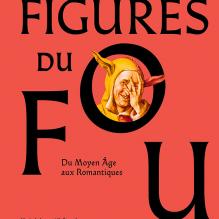Sous la plume de l’essayiste Boris Groys, l’artiste présente quelques traits communs avec le héros de Sacher-Masoch, tandis que Mathieu Copeland fond l’un dans l’autre le livre et l’exposition.
Dans la longue série des « Portraits de l’artiste en… », le court essai issu d’une conférence de Boris Groys apporte une pierre dure avec son portrait de l’artiste en masochiste. L’essayiste d’origine allemande, connu pour sa lecture de la culture et des avant-gardes dans le monde communiste, engage au fouet une charge contre les temps actuels et la contradiction qu’ils portent avec l’idée – son idée – de l’art. Il passe par un chemin détourné déjà emprunté par Gilles Deleuze (dans sa Présentation de Sacher-Masoch, en 1967), celui de l’étrange roman de Sacher-Masoch : La Vénus à la fourrure. On y a puisé de quoi forger le mot « masochisme », que l’usage a réduit à une déviance bien ordinaire quand Groys préfère y lire une figure de l’histoire moderne dont La Vénus…, parue en 1870, serait le témoin. Au travers des relations amoureuses, de leurs figures et paradoxes, c’est la nature même de la temporalité historique que son siècle et les nôtres, vingtième et plus encore vingt et unième, imposent à tout, y compris à l’art.
Sur le modèle du mariage comme paradigme d’une inscription dans la durée de la relation amoureuse, Groys lit dans le personnage de Séverin, qui voit dans son souhait d’un pacte volontaire d’esclavage le moyen de faire durer son bonheur d’amant, le sort que nous partageons comme sujet de la société marchande. À travers le prisme de l’Union soviétique finissante, Groys, revenant sur le sens des avant-gardes, prolonge ici une lecture de la redoutable temporalité nouvelle des œuvres d’art modernes et contemporaines. L’instant consommateur, celui de la décision d’achat et de la satisfaction qui en découle, désormais partagée comme idéal par le monde presque entier, s’est ici substitué à celui de la durée dont le travail de l’écriture (et le temps lent qui va avec) est la référence. Il en ressort une vision salutairement critique du monde de l’art, salutaire bien qu’imprégnée d’une nostalgie pour le grand art qui n’est en effet – sert-il à quelque chose de le regretter ? – plus guère un enjeu de saison.
L’artiste victime consentante
L’artiste moderne aura selon Groys fait ce choix de transformer la sagesse du long terme du mariage en délice de la soumission au nouveau (que les avant-gardes auront promu au risque avéré pour Groys d’une ambivalence du progressisme), à la quantification économique et au succès médiatique. La thèse n’est pas inédite, mais Groys l’affine au travers de son intérêt pour la culture de masse. Faire porter le chapeau de cette sécularisation du grand art au ready-made et au pop art n’est pas non plus une nouveauté : Groys voit cependant les artistes – voire l’artiste en général –, en victimes consentantes, en opérateurs de l’immédiateté de l’art (y compris par les langages qu’il emprunte, photo, vidéo, nouvelles technologies), pris dans la tyrannie des charts (classements). Et produit ainsi un portrait de l’artiste qui partage avec le héros de Sacher-Masoch ce paradoxe qui fait du « ressentiment impuissant […] une source de plaisir infini (p. 47) » et une condition pour la persistance de sa subjectivité. Ce qui constituait l’héroïsme de l’artiste moderne, son combat solitaire et parfois violent contre le monde (et le goût public) prend désormais la forme d’un destin commun et noir d’impuissance. Ainsi l’artiste est-il fait à nouveau, n’en déplaise à Groys, saint ; il reste un pionnier, fût-ce du pire. Groys cependant manque ainsi une dimension historique de la figure de l’artiste quand il entretient implicitement son visage héroïque, incarnation nostalgique de la liberté, sans tenir compte de l’autre versant moderne qui l’a désacralisée de l’intérieur, sécularisée, rendue anonyme, collective. À l’impuissance contemporaine, il reste à opposer une forme bien moins figée, statufiée de l’artiste. Une mobilité qui ne peut se réduire à une superficialité d’Arlequin, de caméléon.
Des textes d’artistes écrits pour la voix
L’entreprise singulière du critique d’art Mathieu Copeland passe entre les mailles des traits nécessairement trop gros du polémiste : ainsi se concrétise-t-elle le plus souvent sous la forme du livre, dont Groys revendique la temporalité longue comme îlot du sens. Loin de la dernière pose cynique que Groys prête assez justement à certaines postures de « curators », la proposition de Copeland, qui s’inscrit dans une continuité depuis le volume publié en 2010 par la Synagogue de Delme, Une exposition à être lue (volume I), brouille les cartes et croise les rôles en proposant de verser la forme exposition dans le livre et le texte parlé. Partition (au sens où l’entendent les musiciens et les artistes conceptuels), catalogue, espace sensible de l’exposition par la nécessité de l’interprétation, le volume III, publié au sein de la programmation « Satellite » du Jeu de paume, réunit des textes d’une quinzaine d’artistes, écrits pour la voix et donné au visiteur. Une brèche dans la temporalité suffocante que décrit Groys.
Boris Groys, Portrait de l’artiste en masochiste, éditions Arkhê, 2013, 54 p., 9,90 €.
Mathieu Copeland, Une exposition à être lue (vol. I), éd. Synagogue de Delme, 2010 ;
Une exposition à être lue (vol. II), éd. HEAD (Haute école d’art de Genève), 2011 ;
Une exposition à être lue (vol. III), coéd. Jeu de paume, Paris/David Roberts Art Foundation, Londres, 2013, catalogue d’« Une exposition parlée, suite pour expositions(s) et publication(s), premier mouvement », dans le cadre de « Satellite 6 », jusqu’au 12 mai, Jeu de paume, Paris.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
L’amour, l’art, le temps et le livre, paradoxes
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°389 du 12 avril 2013, avec le titre suivant : L’amour, l’art, le temps et le livre, paradoxes