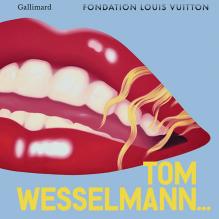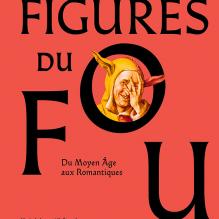Ouvrant de nombreuses pistes de réflexion, l’historien de l’art montre comment a évolué en trois siècles la notion de « faire rêver » jusqu’à la mainmise publicitaire que nous connaissons.
« Ce que nous voudrions, c’est que cette expression placebo, cette béquille de notre contemporanéité qu’est la formule “faire rêver” devienne désagréable à l’oreille de celui qui aura lu cet ouvrage […] Nous voudrions que ce livre sonne comme un avertissement devant l’appel incessant à rêver et, mieux encore, qu’il permette d’en connaître mieux la généalogie pour, éventuellement, y revenir d’une façon plus juste. » Dans son introduction, Thomas Schlesser annonce la conclusion de son ouvrage : précisant qu’il s’appuie sur des exemples allant du XVIIIe au XXIe siècle, il prévient ici que l’époque contemporaine a malheureusement choisi de consacrer le temps de cerveau disponible des foules aux rêves les plus triviaux. Dans ce préliminaire, il reconnaît également « un redoutable problème de terminologie ». C’est que le terme « rêver » a au moins deux sens différents suivant que l’on évoque le sommeil ou la veille.
« Le corpus analysé […] relève majoritairement du champ visuel », précise l’auteur, ce qui est compréhensible pour un historien de l’art mais exclut presque totalement la musique, médium privilégié du « faire rêver », et en grande partie la littérature. On ne peut que regretter qu’il ne se soit pas intéressé, par exemple, au roman de Zola du cycle des « Rougon-Macquart », Le Rêve (1888), non pas tant pour l’histoire racontée que pour l’inspiration qu’en a retirée le symboliste Carlos Schwabe, qui l’a illustré précisément de visions oniriques – un opéra-comique a aussi été tiré du roman en 1891, avec une musique d’Alfred Bruneau (si moderne qu’elle a paru une cacophonie aux contemporains) sur un livret de Louis Gallet. Mais, comme le fait remarquer Thomas Schlesser, « l’ampleur du sujet [est] monumentale » et il faut accepter les choix qu’il a faits pour sa démonstration sur l’« onirogénéité », définie comme la faculté de faire se produire « rêves, rêveries, songes et visions ». On peut ajouter qu’aux XVIIIe et XIXe siècles « faire rêver » a souvent le sens de « faire réfléchir ».
Il est frappant, à la lecture des chapitres consacrés au XIXe siècle, que ne puisse être dégagée aucune constante dans le rêve ou ses causes. Baudelaire rêve devant un Delacroix, Barbey d’Aurevilly devant un Millet et le critique d’art Henri Dumesnil devant un Corot. Thomas Schlesser a beaucoup lu et il cite tant d’exemples que son livre s’apparente parfois à un exercice de name dropping [énumération de noms] égarant le lecteur. L’avantage est qu’il attire l’attention sur des penseurs largement ignorés tel Gabriel Désiré Laverdant (1810-1884), exhumé à propos du fouriérisme. Cette doctrine, avec le saint-simonisme, donne lieu à un développement très réussi consacré au rêve d’une société égalitaire garantissant le bonheur à tous.
Pour l’auteur, spécialiste du rapport de l’art à la politique, la machine à rêver commence à s’enrayer avec les futuristes italiens dont les aspirations mènent tout droit au fascisme. Plus complexe est l’affrontement du surréalisme et du marxisme. Mais il permet de mettre en valeur un écrivain communiste oublié, Maxime Alexandre (1899-1976), auquel on doit ces belles pensées : « Les rêves se réalisent. Les rêves de l’enfant dirigent les actes de l’homme. Les rêves de l’humanité dirigent le monde. » La douche n’en est que plus froide lorsque tombe le couperet des Soviétiques : « Que périssent les rêveurs ».
Plus loin, on se perd un peu : l’American dream et son questionnement par les artistes sont traités en quelques pages, puis l’auteur passe aux Dream Machine de Brion Gysin et Dream House de La Monte Young et Marian Zazeela (années 1960), menant elles-mêmes à un long développement sur la Quinta del Sordo, la maison de Goya décorée de fresques…
La fin du livre est consacrée au cinéma et à la publicité. L’emprise de Walt Disney, créateur de la machine à rêver globalisée, est mise en parallèle avec l’ambition de Cocteau, lequel affirme que son film Le Testament d’Orphée (1960) « permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve ». Thomas Schlesser leur préfère une inconnue : l’écrivaine et journaliste juive Charlotte Beradt (1907-1987), qui, à partir de 1933, « recueillit auprès de ses concitoyens allemands leurs rêves, dans un contexte où le régime d’Hitler visait à coloniser chaque parcelle d’esprit ».Quant à la publicité, elle est championne dans le délicat sport de la récupération des rêves à des fins mercantiles. Ainsi, le joueur de football américain Colin Kaepernick est devenu en 2018 l’icône de l’équipementier Nike après avoir manifesté sa colère contre les violences policières qui frappent les Noirs en mettant un genou à terre pendant l’hymne national, sacrifiant du même coup sa carrière. Le monde global dans lequel nous vivons a un slogan : « Just do it. »
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
À quoi rêvons-nous ?
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°537 du 17 janvier 2020, avec le titre suivant : À quoi rêvons-nous ?